Page 2 sur 4 •  1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 4 
 1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 4 
 JPhMMDemi-dieu
JPhMMDemi-dieu
Toute la question est là, en effet. Question ni neuve ni démodée.infiniment a écrit:Voilà qui n'empêchera pas la fuite en avant, la course vers le toujours plus abject, dans laquelle notre société semble embarquée, j'en ai bien conscience. Mais que faire pour que le plus grand nombre renoue avec ce qui nous semble essentiel, avec ces valeurs qui nous sont chères et qui font la grandeur de l'Homme ? Transmettre ? Enseigner ? Être, comme le disait si bien Jacqueline de Romilly, des passeurs ? Et, par là même, accepter de recevoir quotidiennement crachats et coups de pied ? Je n'en suis même plus à espérer de la reconnaissance... Un peu d'indifférence me suffirait, qu'on nous laisse un peu en paix... Que la petite flamme qui me donne envie de continuer dans cette voie ne s'éteigne pas tout à fait...
Je ne sais pas.
Le seule réponse qui me semble raisonnable à ce jour est bien qu'il faut cultiver son jardin.
Mais je vais essayer de retrouver l'entretien d’Épictète sur l'école et les opinions. Son propos me semble particulièrement bien adapté à ta question.
_________________
Labyrinthe où l'admiration des ignorants et des idiots qui prennent pour savoir profond tout ce qu'ils n'entendent pas, les a retenus, bon gré malgré qu'ils en eussent. — John Locke
Je crois que je ne crois en rien. Mais j'ai des doutes. — Jacques Goimard
 Invité21Fidèle du forum
Invité21Fidèle du forum
Eloge de la folie. La seule chose que je trouve parfois saine en ce monde!
 Thalia de GMédiateur
Thalia de GMédiateur
Zweig, pour son incomparable empathie avec ses personnages.
_________________
Le printemps a le parfum poignant de la nostalgie, et l'été un goût de cendres.
Soleil noir de mes mélancolies.
 pandora51Niveau 10
pandora51Niveau 10
Je vais peut être dire une bêtise, d'autant que je suis loin d'avoir les références cités dans les pages précédentes (parfois j'ai l'impression de manquer de culture...) mais dans ces temps tourmentés pourquoi ne pas lire quelques choses de léger, je pensais au cycle Malaussène de Pennac, c'est drôle, la famille est attachante...Cela permet de s'évader.
 JPhMMDemi-dieu
JPhMMDemi-dieu
infiniment a écrit:Mais que faire pour que le plus grand nombre renoue avec ce qui nous semble essentiel, avec ces valeurs qui nous sont chères et qui font la grandeur de l'Homme ? Transmettre ? Enseigner ? Être, comme le disait si bien Jacqueline de Romilly, des passeurs ? Et, par là même, accepter de recevoir quotidiennement crachats et coups de pied ?
L'étude n'a d'autre fin que de changer nos opinions
En vivant avec de pareils hommes, qui sont dans une telle confusion et une telle ignorance de ce qu'ils disent, du mal qui les possède, ou même de l'existence de ce mal, de son origine et des moyens d'y mettre un terme, il faut, je crois, nous interroger sans cesse : « Ne suis-je pas moi-même un de ceux-là ? Quelle idée me fais-je de moi ? Quel usage fais-je de ce que je suis ? Est-ce comme d'un homme sensé ? Comme d'un homme continent ? Est-ce que jamais, moi aussi, je prononce ces mots : Me voilà préparé à tout ce qui peut arriver ? Et, ne sachant rien, suis-je conscient, comme je devrais l'être, que je ne sais rien ? Vais-je au maître comme à un oracle, tout disposé à me laisser convaincre ? Ne vais-je pas à l'école, moi-aussi, tout morveux, pour apprendre l'histoire des doctrines, pour comprendre des livres que je ne comprenais pas et pour les expliquer à d'autres, le cas échéant ? » Or, homme, tu viens, chez toi, de donner des coups de poing à ton esclave; tu as laissé ta maison toute bouleversée, tu as gêné tes voisins : et te voilà, habillé comme un sage; tu t'assieds et tu te fais juge de la manière dont j'ai expliqué mon texte, et dont j'ai — comment dire ? — débité ce qui me vient à l'esprit. Tu es venu plein d'envie et d'humiliation, parce qu'on ne t'envoie rien de chez toi; et tu es là, ne songeant à rien pendant qu'on parle, sinon à ce que ton père ou ton frère pense de toi. « Que dit-on de moi là-bas ? on pense que je fais des progrès; on dit que je saurai tout quand je reviendrai: certes, je voudrais bien avoir tout appris avant mon retour, mais il y faut beaucoup de travail, et l'on ne m'envoie rien; et à Nicopolis, les bains sont sales; cela ne va pas mieux ici qu'à la maison. » Et ensuite l'on dit : « Je ne tire aucun profit de l'étude » ; et, en effet, qui vient vraiment à l'école ? Qui y vient pour se soigner ? pour se faire purger de ses opinions ? pour prendre conscience de ce qui est nécessaire ? Pourquoi alors vous étonner si vous remportez de l'école ce que vous y apportez ? C'est que vous n'y venez pas pour vous défaire de vos opinions, pour les corriger, pour les remplacer par d'autres. Pourquoi ? Vous en êtes loin. De fait, considérez plutôt si l'on vous donne ici ce qui vous y a fait venir : vous vouliez y parler des théorèmes. Eh bien ! Ne devenez-vous pas plus bavards ? Ne vous fournit-on pas une matière pour exposer vos petits théorèmes ? Est-ce que vous n'analysez pas les syllogismes « instables » ? N'y étudiez-vous pas les lemmes du Menteur et les raisonnements hypothétiques ? Pourquoi donc vous fâcher si vous recevez bien ce que vous vouliez en venant ici ? « Oui, mais, si mon fils meurt, ou mon frère, s'il me faut moi-même mourir ou être mis à la torture, à quoi tout cela me servira-t-il ? » En effet, est-ce bien pour cela que tu es venu ici, est-ce pour cela que tu es assis près de moi ? Est-ce pour cela que tu allumes ta lampe et que tu veilles ? Et, sorti pour te promener, t'es-tu proposé à toi-même, au lieu d'un syllogisme, quelqu'une de tes imaginations pour l'examiner en commun avec tes camarades ? Quand l'as-tu fait ? Et ensuite vous venez dire : « Les théorèmes sont inutiles ». Inutiles pour qui ? Pour ceux qui n'en usent pas comme il faut. Les onguents sont utiles à condition de s'en oindre quand il faut et comme il faut. Les cataplasmes ne sont pas inutiles, les haltères non plus; mais ils ne sont pas utiles à certains et le sont à d'autres. Si maintenant tu me demandes : « Est-ce que les syllogismes sont utiles ? », oui, te répondrai-je, et, si tu veux, je te le montrerai. « A quoi donc m'ont-ils servi ? » Homme, tu ne me demandais pas s'ils t'étaient utiles à toi, mais en général, s'ils étaient utiles. Qu'un malade de dysenterie me demande si le vinaigre est utile, je lui dirai oui. « M'est-il utile à moi ? » Je te dirai : non. Essaie d'abord d'arrêter la diarrhée, de cicatriser tes ulcères. Vous aussi, ô hommes, soignez d'abord vos blessures, arrêtez vos débordements, mettez le calme dans votre esprit, apportez-le à l'école sans le laisser se distraire, et vous verrez quelle force a la logique.
Épictète, XXI, Entretiens, Livre II (traduction Bréhier revue par Aubenque).
_________________
Labyrinthe où l'admiration des ignorants et des idiots qui prennent pour savoir profond tout ce qu'ils n'entendent pas, les a retenus, bon gré malgré qu'ils en eussent. — John Locke
Je crois que je ne crois en rien. Mais j'ai des doutes. — Jacques Goimard
 InfinimentHabitué du forum
InfinimentHabitué du forum
Jacqueline de Romilly, encore et toujours. L'Enseignement en détresse, Paris, Julliard, 1984 (!). Conclusion : "Une gerbe de critique pour un semis d'espoir".
Voyant se développer un peu partout (et, par voie de conséquence, dans l'enseignement) une sorte de défiance et d'hostilité à l'égard du savoir, comment ne pas désirer rappeler que cette acquisition du savoir est aussi entraînement intellectuel, apprentissage de la rigueur, perfectionnement des aptitudes à s'exprimer, à raisonner et à juger ? Comment ne pas vouloir montrer que le savoir permet de comprendre la pensée d'autrui et de nourrir la sienne propre ? C'est là une fonction que l'enseignement remplissait et que, d'après des jugements autorisés, il ne remplit plus ou plus assez. Et, me souvenant de la joie qu'il peut y avoir à guider, rectifier, et encourager un esprit encore malhabile, puis à le voir progresser, j'ai voulu dire ce qu'il en coûterait de laisser proliférer ces doutes et cette démission, et ce qu'il en coûte déjà.
De même, voyant se développer un peu partout (et, par voie de conséquence, dans l'enseignement lui-même) une sorte de dénigrement à l'égard de l'enseignement comme formation morale, comment n'aurais-je pas désiré rappeler que tous ces exercices intellectuels ont pour base et pour sens la recherche de la vérité, et le refus de toute tricherie, que, d'autre part, les enseignements littéraires y joignent l'éveil à bien des valeurs essentielles - à la beauté, à la générosité, à l'humanité. Quand on parle de s'adapter au changement, de coopérer, de s'insérer dans une action commune, et que l'on écrit que cela ne s'apprend pas dans les livres, comment n'aurais-je pas souhaité répondre : Si ! [...] Et, me souvenant de ces moments rayonnants où une classe soudain se passionne pour un problème, ou bien s'enflamme d'affection pour un héros ou une image, comment n'aurais-je pas voulu rappeler ce qu'il coûterait et ce qu'il en a coûté déjà de céder aux finalités économiques ou au matérialisme ambiant et de laisser disparaître de tels moments, ou, pis encore, d'en effacer la portée humaine pour les couler dans le moule d'une certaine actualité ?
Certes, le mal est là, menaçant ; les ravages déjà exercés en témoignent. Parfois il me semble qu'il s'aggrave si vite que ce qui nous guette à plus ou moins long terme ressemble fort à la barbarie. Tout cela pourrait décourager. Mais précisément l'urgence même du danger doit être un stimulant : elle doit aujourd'hui susciter une prise de conscience et un appel à tous.
Mais ce livre est aussi écrit pour tous ceux qui enseignent et dont l'expérience est voisine de la mienne, afin d'empêcher que les bouleversements actuels ne les frappent de doute et ne paralysent leur ardeur. Cet esprit de l'enseignement, que je viens d'évoquer, dépend de nous. Il est possible de préserver par-devers soi ces valeurs, quels que soient les règlements qu'il conviendra d'appliquer, quels que soient aussi les conditions matérielles, les pressions morales, les déboires, ou le poids des habitudes. Il faut pour cela que chacun sache qu'il n'est point seul à les respecter. Il faut que tous gardent, quand ils l'avaient, le sens de la mission qui est la leur et de son importance. Pourquoi imaginer qu'ils n'y réussiront pas ? Qu'ils fassent partie de toutes les associations qui les y aideront ! Qu'ils se rencontrent et échangent leurs expériences et leurs projets ! Qu'en même temps ils prennent conscience du trésor qui leur est confié et du danger que celui-ci est aujourd'hui en train de courir. Il se peut que ce soit difficile, et souvent décourageant. Mais j'ai au moins deux raisons de penser que ce sera possible. D'abord, je l'ai dit, je crois en la lucidité : je crois donc que, plus on a mesuré les implications d'une tâche, plus on est en mesure de l'assurer, quelles que soient les circonstances. Ensuite je crois que la difficulté stimule presque toujours l'ardeur et le courage. Ceux entre les mains de qui repose la charge de transmettre le savoir, le sentiment du bien et le zèle au service de la vérité sauront que tout dépend de leur fermeté et que, pour le moment, on ne les aide pas : cela même, peut-être, les aidera.
_________________
Ah ! la belle chose, que de savoir quelque chose !
 JPhMMDemi-dieu
JPhMMDemi-dieu
Merci. Je souscris entièrement à tout ce qu'elle dit dans ces citations.
Tout est dit.Certes, le mal est là, menaçant ; les ravages déjà exercés en témoignent. Parfois il me semble qu'il s'aggrave si vite que ce qui nous guette à plus ou moins long terme ressemble fort à la barbarie. Tout cela pourrait décourager. Mais précisément l'urgence même du danger doit être un stimulant : elle doit aujourd'hui susciter une prise de conscience et un appel à tous.
_________________
Labyrinthe où l'admiration des ignorants et des idiots qui prennent pour savoir profond tout ce qu'ils n'entendent pas, les a retenus, bon gré malgré qu'ils en eussent. — John Locke
Je crois que je ne crois en rien. Mais j'ai des doutes. — Jacques Goimard
 User5899Demi-dieu
User5899Demi-dieu
Il faut imaginer Sisyphe heureux...l'ENgénu a écrit:En cas de dégoût face à certains débordements de bêtise, je lis Camus.
 JPhMMDemi-dieu
JPhMMDemi-dieu
« Car la pensée de Descartes, ou — ce qui veut dire la même chose — la pensée, pour Descartes, doit être progressive et non régressive. Elle va des idées aux choses, et non des choses aux idées; elle va du simple au complexe; elle avance, en se concrétisant, de l'unité des principes à la multiplicité des diversifications; elle marche de la théorie à l'application, de la métaphysique à la physique, de la physique à la technique, à la médecine, à la morale. Elle ne part pas, ainsi que celle d'Aristote et de la scolastique, d'un divers et d'un Univers donnés, pour remonter de là à l'unité des principes et des causes qui en est le fondement. Pour la pensée cartésienne, le donné, c'est justement l'objet simple de l'intuition intellectuelle, non les objets complexes de la sensation. »
« Aujourd'hui, c'est-à-dire, à une époque où la pensée humaine, reniant sa valeur et sa dignité, se proclame simple manifestation du social, ou encore, simple fonction de la vie; à une époque où dans un monde à nouveau devenu incertain, nous voyons l'homme chercher à tout prix une nouvelle certitude, la payant joyeusement de sa liberté, et de celle de sa propre raison; à une époque de mythe renaissant et d'autorités infaillibles, il nous faut plus que jamais obéir à l'injonction cartésienne qui nous interdit d'admettre pour vrai rien d'autre que ce que nous voyons évidemment être tel; et rester fidèles au message cartésien, qui, proclamant la valeur suprême de la raison, et de la vérité, nous interdit de nous soumettre à une autorité quelconque, autre que la raison, et que la vérité. »
Alexandre Koyré, Entretiens sur Descartes.
« Aujourd'hui, c'est-à-dire, à une époque où la pensée humaine, reniant sa valeur et sa dignité, se proclame simple manifestation du social, ou encore, simple fonction de la vie; à une époque où dans un monde à nouveau devenu incertain, nous voyons l'homme chercher à tout prix une nouvelle certitude, la payant joyeusement de sa liberté, et de celle de sa propre raison; à une époque de mythe renaissant et d'autorités infaillibles, il nous faut plus que jamais obéir à l'injonction cartésienne qui nous interdit d'admettre pour vrai rien d'autre que ce que nous voyons évidemment être tel; et rester fidèles au message cartésien, qui, proclamant la valeur suprême de la raison, et de la vérité, nous interdit de nous soumettre à une autorité quelconque, autre que la raison, et que la vérité. »
Alexandre Koyré, Entretiens sur Descartes.
_________________
Labyrinthe où l'admiration des ignorants et des idiots qui prennent pour savoir profond tout ce qu'ils n'entendent pas, les a retenus, bon gré malgré qu'ils en eussent. — John Locke
Je crois que je ne crois en rien. Mais j'ai des doutes. — Jacques Goimard
 JPhMMDemi-dieu
JPhMMDemi-dieu

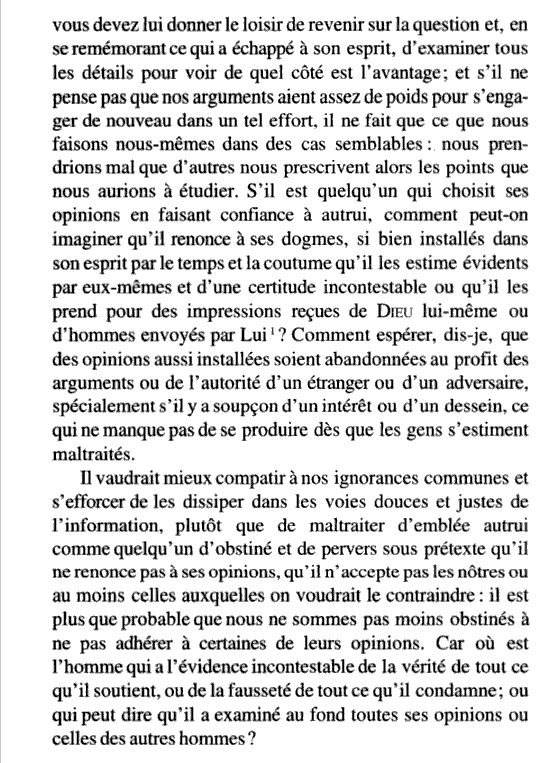
Locke, Essai sur l'entendement humain, Livre IV, chapitre 16, section 4
_________________
Labyrinthe où l'admiration des ignorants et des idiots qui prennent pour savoir profond tout ce qu'ils n'entendent pas, les a retenus, bon gré malgré qu'ils en eussent. — John Locke
Je crois que je ne crois en rien. Mais j'ai des doutes. — Jacques Goimard
 Marie LaetitiaBon génie
Marie LaetitiaBon génie
Merci JPhMM ! Cela tombe très bien en ce moment...
_________________

Si tu crois encore qu'il nous faut descendre dans le creux des rues pour monter au pouvoir, si tu crois encore au rêve du grand soir, et que nos ennemis, il faut aller les pendre... Aucun rêve, jamais, ne mérite une guerre. L'avenir dépend des révolutionnaires, mais se moque bien des petits révoltés. L'avenir ne veut ni feu ni sang ni guerre. Ne sois pas de ceux-là qui vont nous les donner (J. Brel, La Bastille)
Antigone, c'est la petite maigre qui est assise là-bas, et qui ne dit rien. Elle regarde droit devant elle. Elle pense. [...] Elle pense qu'elle va mourir, qu'elle est jeune et qu'elle aussi, elle aurait bien aimé vivre. Mais il n'y a rien à faire. Elle s'appelle Antigone et il va falloir qu'elle joue son rôle jusqu'au bout...
Et on ne dit pas "voir(e) même" mais "voire" ou "même".
 JPhMMDemi-dieu
JPhMMDemi-dieu
N'est-ce pas...Marie Laetitia a écrit:Cela tombe très bien en ce moment...
De rien. :o)
_________________
Labyrinthe où l'admiration des ignorants et des idiots qui prennent pour savoir profond tout ce qu'ils n'entendent pas, les a retenus, bon gré malgré qu'ils en eussent. — John Locke
Je crois que je ne crois en rien. Mais j'ai des doutes. — Jacques Goimard
 ErgoDevin
ErgoDevin

_________________
"You went to a long-dead octopus for advice, and you're going to blame *me* for your problems?" -- Once Upon a Time
"The gull was your ordinary gull." -- Wittgenstein's Mistress
« Cède, cède, cède, je le veux ! » écrivait Ronin, le samouraï. (Si vous cherchez un stulo-plyme, de l'encre, récap de juillet 2024)
 JPhMMDemi-dieu
JPhMMDemi-dieu
DISCOURS SUR LES MOTIFS QUI DOIVENT NOUS ENCOURAGER AUX SCIENCES
Extrait.
Extrait.
Montesquieu, prononcé le 15 novembre 1725.Les sciences sont donc très utiles, en ce qu'elles guérissent les peuples des préjugés destructifs; mais, comme nous pouvons espérer qu'une nation qui les a une fois cultivées, les cultivera toujours assez pour ne pas tomber dans le degré de grossièreté et d'ignorance qui peut causer sa ruine, nous allons parler des autres motifs qui doivent nous engager à nous y appliquer.
Le premier, c'est la satisfaction intérieure que l'on ressent lorsque l'on voit augmenter l'excellence de son être, et que l'on rend plus intelligent un être intelligent. Le second, c'est une certaine curiosité que tous les hommes ont, et qui n'a jamais été si raisonnable que dans ce siècle-ci. Nous entendons dire tous les jours que les bornes des connoissances des hommes viennent d'être infiniment reculées, que les savants sont étonnés de se trouver si savants, et que la grandeur des succès les a fait quelquefois douter de la vérité des succès : ne prendrons-nous aucune part à ces bonnes nouvelles? Nous savons que l'esprit humain est allé très loin: ne verrons-nous pas jusqu'où il a été, le chemin qu'il a fait, le chemin qui lui reste à faire, les connoissances qu'il se flatte, celles qu'il ambitionne , celles qu'il désespère d'acquérir?
Un troisième motif qui doit nous encourager aux sciences, c'est l'espérance bien fondée d'y réussir. Ce qui rend les découvertes de ce siècle si admirables, ce ne sont pas des vérités simples qu'on a trouvées, mais des méthodes pour les trouver; ce n'est pas une pierre pour l'édifice, mais les instruments et les machines pour le bâtir tout entier.
Un homme se vante d'avoir de l'or ;un autre se vante d'en savoir faire : certainement le Véritable riche seroit celui qui sauroit faire de l'or.
Un quatrième motif, c'est notre propre bonheur. L'amour de l'élude est presque en nous la seule passion éternelle; toutes les autres nous quittent, à mesure que cette misérable machine qui nous les donne s'approche de sa ruine. L'ardente et impétueuse jeunesse, qui vole de plaisirs en plaisirs , peut quelquefois nous les donner purs, parce qu'avant que nous ayons eu le temps de sentir les épines do l'un, elle nous fait jouir de l'autre. Dans l'âge qui la suit, les sens peuvent nous offrir des voluptés, mais presque jamais des plaisirs. C'est pour lors que nous sentons que notre ame est la principale partie de nous-mêmes; et, comme si la chaîne qui l'attache aux sens étoit rompue, chez elle seule sont les plaisirs, mais tous indépendants.
Que si dans ce temps nous ne donnons point à notre ame des occupations qui lui conviennent, cette ame faite -pour être occupée, et qui ne l'est point, tombe dans un ennui terrible qui nous mène a l'anéantissement; et si, révoltés contre la nature, nous nous obstinons h chercher des plaisirs qui ne sont point faits pour nous, ils semblent nous fuir à mesure que nous en approchons. Une jeunesse folâtre triomphe de son bonheur, et nous insulte sans cesse; comme elle sent tous ses avantages, elle nous les fait sentir; dans les assemblées les plus vives toute la joie est pour elle, et pour nous les regrets. L'étude nous guérit de ces inconvénients, et les plaisirs qu'elle nous donne ne nous avertissent point que nous vieillissons.
Il faut se faire un bonheur qui nous suive dans tous les âges; la vie est si courte, que l'on doit compter pour rien une félicité qui ne dure pas autant que nous. La vieillesse oisive est la seule qui soit à charge : en elle-même elle ne l'est point; car si elle nous dégrade dans un certain monde, elle nous accrédite dans un autre. Ce n'est point le vieillard qui est insupportable, c'est l'homme; c'est l'homme qui s'est mis dans la nécessité de périr d'ennui, ou d'aller de sociétés en sociétés chercher tous les plaisirs.
Un autre motif qui doit nous encourager à nous appliquera l'étude, c'est l'utilité que peut en tirer la société dont nous faisons partie; nous pourrons joindre a tant de commodités que nous avons, bien des commodités que nous n'avons pas encore. Le commerce, la navigation, l'astronomie, la géographie, la médecine, la physique , ont reçu mille avantages des travaux de ceux qui nous ont précédés : n'est-ce pas un beau dessein que de travailler a laisser après nous les hommes plus heureux que nous ne l'avons été?
Nous ne nous plaindrons point, comme un courtisan de Néron, de l'injustice de tous les siècles envers ceux qui ont fait fleurir les sciences et les arts : Miron, qui fere hominum animas ferarumque œre deprehenderat, non invenit hœredem. Notre siècle est bien peut-être aussi ingrat qu'un autre; mais la postérité nous rendra justice, et paiera les dettes de la génération présente.
On pardonne au négociant, riche par le retour de ses vaisseaux, de rire de l'inutilité de celui qui l'a conduit comme par la main dans des mers immenses. On consent qu'un guerrier orgueilleux, chargé d'honneurs et de titres, méprise les Archimèdes de nos jours, qui ont mis son courage en œuvre. Les hommes qui, de dessein formé, sont utiles a la société, les gens qui l'aiment, veulent bien être traités comme s'ils lui étoient à charge.
Après avoir parlé des sciences, nous dirons un mot des belles-lettres. Les livres de pur esprit, comme ceux de poésie et d'éloquence, ont au moins des utilités générales; et ces sortes d'avantages sont souvent plus grands que des avantages particuliers.
Nous apprenons dans les livres de pur esprit l'art d'écrire, l'art de rendre nos idées, de les exprimer noblement, vivement, avec force, avec grâce, avec ordre, et avec cette variété qui délasse l'esprit.
Il n'y a personne qui n'ait vu en sa vie des gens qui, appliqués à leur art, auraient pu le pousser très loin, mais qui, faute d'éducation, incapables également de rendre une idée et de la suivre, perdoient tout l'avantage de leurs travaux et de leurs talents.
Les sciences se touchent les unes les autres; les plus abstraites aboutissent a celles qui le sont moins, et le corps des sciences tient tout entier aux belles-lettres. Or, les sciences gagnent beaucoup h être traitées d'une manière ingénieuse et délicate; c'est par-là qu'on en été la sécheresse, qu'on prévient la lassitude., et qu'on les met h la portée de tous les esprits. Si le P. Malebranche avoit été un écrivain moins enchanteur, sa philosophie seroit restée dans le fond d'un collège, comme dans une espèce de monde souterrain. Il y a des cartésiens qui n'ont jamais lu que les Mondes de M. de Fontenelle; cet ouvrage est plus utile qu'on ouvrage plus fort , parce que c'est le plus sérieux que la plupart des gens soient en état de lire.
Il ne faut pas juger de l'utilité d'un ouvrage par le style que l'auteur a choisi : souvent on a dit gravement des choses puériles ; souvent on a dit en badinant des vérités très sérieuses.
Mais, indépendamment de ces considérations , les livres qui récréent l'esprit des honnêtes gens ne sont pas inutiles. De pareilles lectures sont les amusements les plus innocents des gens du monde, puisqu'ils suppléent presque toujours aux jeux, aux débauches, aux conversations médisantes, aux projets et aux démarches de l'ambition.
_________________
Labyrinthe où l'admiration des ignorants et des idiots qui prennent pour savoir profond tout ce qu'ils n'entendent pas, les a retenus, bon gré malgré qu'ils en eussent. — John Locke
Je crois que je ne crois en rien. Mais j'ai des doutes. — Jacques Goimard
 JPhMMDemi-dieu
JPhMMDemi-dieu
A VARRON. Rome, avril.
Caninius, votre ami et le mien, vint me visiter l'autre jour fort tard ; il partait, me dit-il, le lendemain de bonne heure, pour aller vous retrouver. Comme je voulais lui donner une lettre pour vous, je le priai d'avoir la bonté de la venir prendre le matin, et je passai une partie de la nuit à écrire. Mais notre homme ne revint pas et je crus qu'il m'avait oublie. Je n'aurais pas, manqué de vous envoyer ma lettre par mes gens, s'il ne m'avait dit que vous partiez vous-même de Tusculum le lendemain de très-bonne heure. Quelques jours se passent, et quand je m'y attends le moins, voila un beau matin Caninius qui arrive. Il partait. Quoique ma lettre fût du réchauffé, il y a eu de si grandes nouvelles depuis! je ne voulus pas perdre ma peine, et la lui remis. J'ai causé avec lui : je sais que c'est un homme grave et qui vous aime avec passion. Je suppose qu'il vous rendra compte de notre entretien. Mais voici un conseil que je vous donne, et que je me donne aussi à moi-même. Si nous ne pouvons nous soustraire aux propos, tâchons du moins de nous soustraire aux regards. Ils sont tellement insolents dans leur victoire qu'ils nous regardent comme des vaincus. Or, l'aspect de ces vaincus les met mal a l'aise, et ils souffrent de nous voir en vie. Les choses étant ainsi à Rome, pourquoi donc, me direz-vous, n'avoir pas suivi mon exemple et ne pas vous être éloigné? C'est, mon cher Varron, que vous êtes plus habile que moi et que bien d'autres; c'est que vous avez, je crois, été devin, et qu'aucune de vos prévisions ne vous a trompé. Mais tout le monde a-t-il des yeux de lynx, pour ne pas se heurter et chopper dans de pareilles ténèbres? — J'ai toutefois pensé souvent à sortir d'ici, pour n'avoir point à voir ce qu'on y fait ni à entendre ce qu'on y dit. Mais je me disais : On me rencontrera, et qu'on le pense ou non, on dira : « il a eu peur, Il s'est sauvé; on bien il a un projet en tête; un navire l'attend. » Ceux qui n'y entendraient pas malice, et qui au fond me connaîtraient le mieux peut-être, auraient vu chez moi l'intention de fuir des visages odieux. Voila ce qui m'a fait rester à Rome, ou d'ailleurs le retour journalier des mêmes scènes a fini par user ma sensibilité. — Vous savez maintenant mon histoire. Quant à vous, vous ferez bien de rester encore a l'écart; attendez que l'enthousiasme des premiers moments tombe et qu'on sache où nous en sommes; car je crois que tout est fini maintenant. Il importe donc de connaître les dispositions du vainqueur et la pente des affaires. Il ne m'est pas difficile de m'en faire une idée, mais j'attends. Gardez-vous surtout du séjour de Haies; tant du moins que ce tapage ne se sera pas assoupi un peu. Il nous sera plus honorable, si nous quittons Rome pour Baïes, de paraître y aller pour frémir, et non pour y prendre le plaisir des bains. Je m'en rapporte à vous : que nous vivions ensemble au sein de l'étude; je ne tiens qu'a cela. L'élude, qui n'était autrefois qu'un charme pour nous, est aujourd'hui notre ancre de salut; au premier appel, on nous verrait accourir, et nous nous porterions avec joie, comme architectes ou comme manœuvres, à la reconstruction de l'édifice politique. Que si l'on ne veut pas de nos services, il nous sera permis du moins de composer et de lire des traités de gouvernement; et si la politique d'action nous est interdite à la curie et au forum, nous ferons de la politique de théorie dans des livres, à l'exemple des plus illustres sages de l'antiquité; et nous nous livrerons à une étude approfondie des mœurs et des lois. Voilà mes rêves. Faites-moi la grâce de me dire à votre tour vos vues et vos projets.
Cicéron, Ad Familiares, Livre IX, Lettre 2
Traduction M. Nisard
Caninius, votre ami et le mien, vint me visiter l'autre jour fort tard ; il partait, me dit-il, le lendemain de bonne heure, pour aller vous retrouver. Comme je voulais lui donner une lettre pour vous, je le priai d'avoir la bonté de la venir prendre le matin, et je passai une partie de la nuit à écrire. Mais notre homme ne revint pas et je crus qu'il m'avait oublie. Je n'aurais pas, manqué de vous envoyer ma lettre par mes gens, s'il ne m'avait dit que vous partiez vous-même de Tusculum le lendemain de très-bonne heure. Quelques jours se passent, et quand je m'y attends le moins, voila un beau matin Caninius qui arrive. Il partait. Quoique ma lettre fût du réchauffé, il y a eu de si grandes nouvelles depuis! je ne voulus pas perdre ma peine, et la lui remis. J'ai causé avec lui : je sais que c'est un homme grave et qui vous aime avec passion. Je suppose qu'il vous rendra compte de notre entretien. Mais voici un conseil que je vous donne, et que je me donne aussi à moi-même. Si nous ne pouvons nous soustraire aux propos, tâchons du moins de nous soustraire aux regards. Ils sont tellement insolents dans leur victoire qu'ils nous regardent comme des vaincus. Or, l'aspect de ces vaincus les met mal a l'aise, et ils souffrent de nous voir en vie. Les choses étant ainsi à Rome, pourquoi donc, me direz-vous, n'avoir pas suivi mon exemple et ne pas vous être éloigné? C'est, mon cher Varron, que vous êtes plus habile que moi et que bien d'autres; c'est que vous avez, je crois, été devin, et qu'aucune de vos prévisions ne vous a trompé. Mais tout le monde a-t-il des yeux de lynx, pour ne pas se heurter et chopper dans de pareilles ténèbres? — J'ai toutefois pensé souvent à sortir d'ici, pour n'avoir point à voir ce qu'on y fait ni à entendre ce qu'on y dit. Mais je me disais : On me rencontrera, et qu'on le pense ou non, on dira : « il a eu peur, Il s'est sauvé; on bien il a un projet en tête; un navire l'attend. » Ceux qui n'y entendraient pas malice, et qui au fond me connaîtraient le mieux peut-être, auraient vu chez moi l'intention de fuir des visages odieux. Voila ce qui m'a fait rester à Rome, ou d'ailleurs le retour journalier des mêmes scènes a fini par user ma sensibilité. — Vous savez maintenant mon histoire. Quant à vous, vous ferez bien de rester encore a l'écart; attendez que l'enthousiasme des premiers moments tombe et qu'on sache où nous en sommes; car je crois que tout est fini maintenant. Il importe donc de connaître les dispositions du vainqueur et la pente des affaires. Il ne m'est pas difficile de m'en faire une idée, mais j'attends. Gardez-vous surtout du séjour de Haies; tant du moins que ce tapage ne se sera pas assoupi un peu. Il nous sera plus honorable, si nous quittons Rome pour Baïes, de paraître y aller pour frémir, et non pour y prendre le plaisir des bains. Je m'en rapporte à vous : que nous vivions ensemble au sein de l'étude; je ne tiens qu'a cela. L'élude, qui n'était autrefois qu'un charme pour nous, est aujourd'hui notre ancre de salut; au premier appel, on nous verrait accourir, et nous nous porterions avec joie, comme architectes ou comme manœuvres, à la reconstruction de l'édifice politique. Que si l'on ne veut pas de nos services, il nous sera permis du moins de composer et de lire des traités de gouvernement; et si la politique d'action nous est interdite à la curie et au forum, nous ferons de la politique de théorie dans des livres, à l'exemple des plus illustres sages de l'antiquité; et nous nous livrerons à une étude approfondie des mœurs et des lois. Voilà mes rêves. Faites-moi la grâce de me dire à votre tour vos vues et vos projets.
Cicéron, Ad Familiares, Livre IX, Lettre 2
Traduction M. Nisard
_________________
Labyrinthe où l'admiration des ignorants et des idiots qui prennent pour savoir profond tout ce qu'ils n'entendent pas, les a retenus, bon gré malgré qu'ils en eussent. — John Locke
Je crois que je ne crois en rien. Mais j'ai des doutes. — Jacques Goimard
 RoninMonarque
RoninMonarque
Raymond Aron, Jean-Claude Michéa, George Orwell.
_________________

 NadejdaGrand sage
NadejdaGrand sage
Eurêka ! (par Imre Kertész)
Avant toute chose, je dois vous faire un aveu, un aveu peut-être étrange mais sincère. Depuis que je suis monté dans l'avion pour venir ici, à Stockholm, recevoir le prix Nobel qui m'a été décerné cette année, je sens dans mon dos le regard scrutateur d'un observateur impassible ; et en cet instant solennel qui me place au centre de l'attention générale, je m'identifie plutôt à ce témoin imperturbable qu'à l'écrivain soudain révélé au monde entier. Et j'espère seulement que le discours que je vais prononcer pour cette occasion m'aidera à mettre fin à cette dualité, à réunir ces deux personnes qui vivent en moi.
Pour l'instant, moi-même, je ne comprends pas assez clairement l'aporie que je sens entre cette haute distinction et mon œuvre, ou plutôt ma vie. J'ai peut-être vécu trop longtemps dans des dictatures, dans un environnement intellectuel hostile et désespérément étranger, pour pouvoir prendre conscience de mon éventuelle valeur littéraire : la question ne valait tout simplement pas la peine d'être posée. De surcroît, on me faisait comprendre de toutes parts que le « sujet » qui occupait mes pensées, qui m'habitait, était dépassé et inintéressant. Voilà pourquoi(,) j'ai toujours considéré l'écriture comme une affaire strictement privée, ce qui rejoignait d'ailleurs mes plus intimes convictions.
Dire qu'il s'agit d'une affaire privée n'exclut nullement le sérieux, même si ce dernier semblait quelque peu ridicule dans un monde où seul le mensonge était pris au sérieux. Or, l'axiome philosophique définissait le monde comme réalité existant indépendamment de nous. Mais moi, en 1955, par un beau jour de printemps, j'ai compris d'un coup qu'il n'existait qu'une seule réalité, et que cette réalité, c'était moi, ma vie, ce cadeau fragile et d'une durée incertaine que des puissances étrangères et inconnues s'étaient approprié, avaient nationalisé, déterminé et scellé, et j'ai su que je devais la reprendre à ce monstrueux Moloch qu'on appelle l'histoire, car elle n'appartenait qu'à moi et je devais en disposer en tant que telle.
En tout cas, cela m'opposait radicalement à tout ce qui m'entourait, à cette réalité qui n'était peut-être pas objective, mais certainement indéniable. Je parle de la Hongrie communiste, du socialisme qui promettait un avenir radieux. Si le monde est une réalité objective qui existe indépendamment de nous, alors l'individu n'est qu'un objet - y compris pour lui-même, et l'histoire de sa vie n'est qu'une suite incohérente de hasards historiques qu'il peut certes contempler, mais qui ne le concernent pas. Il ne lui sert à rien de les ordonner en un ensemble cohérent, car son moi subjectif ne saurait assumer la responsabilité des éléments trop objectifs qui pourraient s'y trouver.
Un an plus tard, en 1956, a éclaté la révolution hongroise. Pour un seul et bref instant, le pays est devenu subjectif. Mais les chars soviétiques ont bien vite rétabli l'objectivité.
S'il vous semble que je fais de l'ironie, alors pensez, je vous prie, à ce que sont devenus la langue et les mots au cours du 20e siècle. Selon moi, il est vraisemblable que la plus importante, la plus bouleversante découverte des écrivains de notre temps est que la langue, telle que nous l'avons héritée d'une culture ancienne, est tout simplement incapable de représenter les processus réels, les concepts autrefois simples. Pensez à Kafka, pensez à Orwell qui ont vu la langue ancienne fondre dans leurs mains, comme s'ils l'avaient mise au feu pour ensuite en montrer les cendres où apparaissaient des images nouvelles et jusqu'alors inconnues.
Mais je voudrais revenir à mon affaire strictement personnelle, c'est-à-dire à l'écriture. Il y a là quelques questions que tout homme dans ma situation ne se pose même pas. Jean-Paul Sartre, par exemple, a consacré tout un opuscule à la question de savoir pour qui on écrit. La question est intéressante, mais elle peut également être dangereuse et je suis en tout cas reconnaissant à la vie de n'avoir jamais eu à y réfléchir. Voyons en quoi consiste le danger. Par exemple, si on vise une classe sociale qu'on voudrait non seulement divertir mais aussi influencer, il faut avant tout prendre en considération son propre style et se demander s'il est adapté à l'objectif qu'on s'est fixé. L'écrivain est bientôt assailli de doutes : le problème est qu'il est dès lors occupé à s'observer lui-même. De plus, comment pourrait-il savoir quelles sont les vraies attentes de son public, ce qui lui plaît vraiment ? Il ne peut tout de même pas interroger chaque individu. D'ailleurs, cela ne servirait à rien. En définitive, son seul point de départ possible est l'idée qu'il a lui-même de son public, les exigences que lui-même lui attribue, l'effet qu'aura sur lui-même l'influence qu'il souhaite exercer. Pour qui donc l'écrivain écrit-il ? La réponse est évidente : pour lui-même.
Moi au moins, je peux dire que j'étais arrivé à cette réponse sans aucun détour. Il est vrai que mon cas était plus simple : je n'avais pas de public et ne voulais influencer personne. Je n'avais pas de but précis quand j'ai commencé à écrire et ce que j'écrivais ne s'adressait à personne. Si mon écriture n'avait pas d'objectif clairement exprimable, elle consistait néanmoins à garder une fidélité formelle et linguistique à mon sujet, rien d'autre. Il importait de le préciser à cette époque ridicule mais triste où la littérature dite engagée était dirigée par l'Etat.
Il m'aurait en revanche été plus difficile de répondre à la question, posée à juste titre et non sans un certain scepticisme, de savoir pourquoi on écrit. A nouveau, j'ai eu de la chance, car je n'ai jamais eu l'occasion de trancher cette question. J'ai d'ailleurs relaté fidèlement cet événement dans mon roman intitulé Le refus. Je me trouvais dans le couloir désert d'un immeuble administratif et j'entendais des pas résonner dans un couloir perpendiculaire, c'est tout. J'ai été pris d'une sorte d'agitation particulière, les pas venaient dans ma direction, c'étaient ceux d'une seule personne que je ne voyais pas, et brusquement, j'ai eu l'impression d'en entendre marcher des centaines de milliers, une véritable colonne dont les pas retentissaient et alors j'ai saisi la force d'attraction de ce défilé, de ces pas. Là, dans ce couloir, j'ai compris en une seule seconde l'ivresse de l'abandon de soi, le plaisir vertigineux de se fondre dans la masse, ce que Nietzsche - dans un autre contexte, certes, mais avec pertinence - nomme l'extase dionysiaque. Une force quasi physique me poussait et m'attirait dans les rangs, je sentais que je devais m'appuyer et m'aplatir contre le mur, pour ne pas céder à cette attraction.
Je rends compte de cet instant intense comme je l'ai vécu ; la source d'où il avait jailli telle une vision semblait se trouver en dehors de moi et non en moi-même. Tout artiste connaît de tels instants. Autrefois, on les s'appelait des inspirations soudaines. Mais je ne mettrais pas ce que j'ai vécu au nombre des expériences artistiques. Je parlerais plutôt d'une prise de conscience existentielle, laquelle ne m'a pas donné la maîtrise de mon art, car j'ai dû encore longtemps en chercher les outils, mais celle de ma vie, alors que je l'avais presque perdue. Il y était question de la solitude, d'une vie plus difficile, de ce dont j'ai parlé au début : il s'agissait de sortir du cortège enivrant, de l'histoire qui dépouille l'homme de sa personnalité et de son destin. J'avais constaté avec effroi que dix ans après être revenu des camps nazis et avec pour ainsi dire un pied dans la fascination de la terreur stalinienne, il ne me restait plus de tout cela qu'une vague impression et quelques anecdotes. Comme si c'était arrivé à quelqu'un d'autre.
Il est évident que ces instants visionnaires ont une longue histoire que Sigmund Freud déduirait peut-être du refoulement de quelque traumatisme. Qui sait, peut-être aurait-il raison. Or moi aussi, je penche plutôt pour la rationalité et suis loin de tout mysticisme ou enthousiasme : quand je parle de vision, j'entends une réalité qui a pris la forme du surnaturel - à savoir la révélation soudaine, on pourrait dire révolutionnaire, d'une idée qui mûrissait en moi, une chose qu'exprime l'antique exclamation « eurêka ! ». « J'ai trouvé ! » Certes, mais quoi ?
J'ai dit un jour que pour moi, ce qu'on appelle le socialisme avait la même signification qu'eut pour Marcel Proust la madeleine qui, trempée dans le thé, avait ressuscité en lui les saveurs du temps passé. Après la défaite de la révolution de 1956, j'ai décidé, essentiellement pour des raisons linguistiques, de rester en Hongrie. Ainsi j'ai pu observer, non plus en tant qu'enfant, mais avec ma tête d'adulte, le fonctionnement d'une dictature. J'ai vu comment un peuple est amené à nier ses idéaux, j'ai vu les débuts de l'adaptation, les gestes prudents, j'ai compris que l'espoir était un instrument du mal et que l'impératif catégorique de Kant, l'éthique, n'étaient que les valets dociles de la subsistance.
Peut-on imaginer liberté plus grande que celle dont jouit un écrivain dans une dictature relativement limitée, pour ainsi dire fatiguée voire décadente ? Dans les années soixante, la dictature hongroise était arrivée à un point de consolidation qu'on peut appeler consensus social et auquel le monde occidental donnerait plus tard, avec condescendance, le petit nom de « communisme de goulache » : après l'animosité du début, le communisme hongrois était devenu d'un coup le communisme préféré de l'Occident. Dans le bourbier de ce consensus, il ne restait qu'une alternative : ou bien renoncer définitivement au combat, ou bien chercher les chemins tortueux de la liberté intérieure. Un écrivain n'a pas de grands besoins, un crayon et du papier suffisent à l'exercice de son art. Le dégoût et la dépression avec lesquels je me réveillais chaque matin m'introduisaient vite dans le monde que je voulais décrire. Je me suis rendu compte que je décrivais un homme broyé par la logique d'un totalitarisme en vivant moi-même dans un autre totalitarisme, et cela a sans aucun doute fait de la langue de mon roman un moyen de communication suggestif. Si j'évalue en toute sincérité ma situation à cette époque-là, je ne sais pas si en Occident, dans une société libre, j'aurais été capable d'écrire le même roman que celui qui est connu aujourd'hui sous le titre d'Etre sans destin et qui a obtenu la plus haute distinction de l'Académie Suédoise.
Non, car j'aurais certainement eu d'autres préoccupations. Je n'aurais certes pas renoncé à chercher la vérité, mais c'eût été peut-être une autre vérité. Dans le marché libre des livres et des esprits, je me serais peut-être efforcé de trouver une forme romanesque plus brillante : j'aurais pu, par exemple, fragmenter la narration pour ne raconter que les moments frappants. Sauf que dans les camps de concentration, mon héros ne vit pas son propre temps, puisqu'il est dépossédé de son temps, de sa langue, de sa personnalité. Il n'a pas de mémoire, il est dans l'instant. Si bien que le pauvre doit dépérir dans le piège morne de la linéarité et ne peut se libérer des détails pénibles. Au lieu d'une succession spectaculaire de grands moments tragiques, il doit vivre le tout, ce qui est pesant et offre peu de variété, comme la vie.
Mais cela m'a permis de tirer des enseignements étonnants. La linéarité exige que chaque situation s'accomplisse intégralement. Elle m'a interdit, par exemple, de sauter élégamment une vingtaine de minutes pour la seule raison que ces vingt minutes béaient devant moi tel un gouffre noir, inconnu et effrayant comme une fosse commune. Je parle de ces vingt minutes qui se sont écoulées sur le quai du camp d'extermination de Birkenau avant que les personnes descendues des wagons ne se retrouvent devant l'officier qui faisait la sélection. Moi-même, j'avais un souvenir approximatif de ces vingt minutes, mais le roman m'interdisait de me fier à mes réminiscences. Presque tous les témoignages, confessions et souvenirs de survivants que j'avais lus étaient d'accord sur le fait que tout s'était déroulé très vite et dans la plus grande confusion : les portes des wagons s'ouvraient violemment au milieu des cris et des aboiements, les hommes étaient séparés des femmes, dans une cohue démentielle ils se retrouvaient devant un officier qui leur jetait un rapide coup d'œil, montrait quelque chose en tendant le bras, puis ils se retrouvaient en tenue de prisonnier.
Moi, j'avais un autre souvenir de ces vingt minutes. En cherchant des sources authentiques, j'ai commencé par lire Tadeusz Borowski, ses récits limpides, d'une cruauté masochiste, dont celui qui s'intitule « Au gaz, messieurs-dames ! » Ensuite, j'ai eu entre les mains une série de photos qu'un SS avait prises sur le quai de Birkenau lors de l'arrivée des convois et que les soldats américains ont retrouvées à Dachau, dans l'ancienne caserne des SS. J'ai été sidéré par ces photos : beaux visages souriants de femmes, de jeunes hommes au regard intelligent, pleins de bonne volonté, prêts à coopérer. Alors j'ai compris comment et pourquoi ces vingt minutes humiliantes d'inaction et d'impuissance s'étaient estompées dans leur mémoire. Et quand en pensant que tout cela s'était répété jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, durant de longues années, j'ai pu entrevoir la technique de l'horreur, j'ai compris comment on pouvait retourner la nature humaine contre la vie humaine.
J'avançais ainsi, pas à pas, sur la voie linéaire des découvertes ; c'était, si on veut, ma méthode heuristique. J'ai vite compris que les questions de savoir pour qui et pour quoi j'écrivais ne m'intéressaient pas. Une seule question me travaillait : qu'avais-je encore en commun avec la littérature ? Car il était clair qu'une ligne infranchissable me séparait de la littérature et de ses idéaux, de son esprit, et cette ligne - comme tant d'autres choses - s'appelle Auschwitz. Quand on écrit sur Auschwitz, il faut savoir que, du moins dans un certain sens, Auschwitz a mis la littérature en suspens. A propos d'Auschwitz, on ne peut écrire qu'un roman noir ou, sauf votre respect, un roman-feuilleton dont l'action commence à Auschwitz et dure jusqu'à nos jours. Je veux dire par là qu'il ne s'est rien passé depuis Auschwitz qui ait annulé Auschwitz, qui ait réfuté Auschwitz. Dans mes écrits, l'Holocauste n'a jamais pu apparaître au passé.
On dit à mon propos - pour m'en féliciter ou pour me le reprocher - que je suis l'écrivain d'un seul thème, l'Holocauste. Je ne trouve rien à y redire, pourquoi n'accepterais-je pas, avec quelques réserves, la place qui m'a été attribuée sur l'étagère idoine des bibliothèques ? En effet, quel écrivain aujourd'hui n'est pas un écrivain de l'Holocauste ? Je veux dire qu'il n'est pas nécessaire de choisir expressément l'Holocauste comme sujet pour remarquer la dissonance qui règne depuis des décennies dans l'art contemporain en Europe. De plus : il n'y a, à ma connaissance, pas d'art valable ou authentique où on ne sente pas la cassure qu'on éprouve en regardant le monde après une nuit de cauchemars, brisé et perplexe. Je n'ai jamais eu la tentation de considérer les questions relatives à l'Holocauste comme un conflit inextricable entre les Allemands et les Juifs ; je n'ai jamais cru que c'était l'un des chapitres du martyre juif qui succède logiquement aux épreuves précédentes ; je n'y ai jamais vu un déraillement soudain de l'histoire, un pogrome d'une ampleur plus importante que les autres ou encore les conditions de la fondation d'un Etat juif. Dans l'Holocauste, j'ai découvert la condition humaine, le terminus d'une grande aventure où les Européens sont arrivés au bout de deux mille ans de culture et de morale.
A présent il faut réfléchir au moyen d'aller plus loin. Le problème d'Auschwitz n'est pas de savoir s'il faut tirer un trait dessus ou non, si nous devons en garder la mémoire ou plutôt le jeter dans le tiroir approprié de l'histoire, s'il faut ériger des monuments aux millions de victimes et quel doit être ce monument. Le véritable problème d'Auschwitz est qu'il a eu lieu, et avec la meilleure ou la plus méchante volonté du monde, nous ne pouvons rien y changer. En parlant de « scandale », le poète hongrois catholique János Pilinszky a sans doute trouvé la meilleure dénomination de ce pénible état de fait ; et par là, il voulait à l'évidence dire qu'Auschwitz a eu lieu dans la culture chrétienne et constitue ainsi pour un esprit métaphysique une plaie ouverte.
D'anciennes prophéties disent que Dieu est mort. Il ne fait aucun doute, qu'après Auschwitz, nous sommes restés livrés à nous-mêmes. Il nous a fallu créer nos valeurs, jour après jour, par un travail éthique opiniâtre mais invisible qui finira par produire les valeurs qui donneront peut-être naissance à la nouvelle culture européenne. Que l'Académie Suédoise ait jugé bon de distinguer précisément mon œuvre prouve à mes yeux que l'Europe éprouve à nouveau le besoin que les survivants d'Auschwitz et de l'Holocauste lui rappellent l'expérience qu'ils ont été obligés d'acquérir. A mes yeux, permettez-moi de le dire, c'est une marque de courage, voire d'une certaine détermination ; car on a souhaité me voir venir ici tout en se doutant de ce que j'allais dire. Mais ce qui a été révélé à travers la solution finale et « l'univers concentrationnaire » ne peut pas prêter à confusion, et la seule possibilité de survivre, de conserver des forces créatrices est de découvrir ce point zéro. Pourquoi cette lucidité ne serait-elle pas fertile ? Au fond des grandes découvertes, même si elles se fondent sur des tragédies extrêmes, réside toujours la plus admirable valeur européenne, à savoir le frémissement de la liberté qui confère à notre vie une certaine plus-value, une certaine richesse en nous faisant prendre conscience de la réalité de notre existence et de notre responsabilité envers celle-ci.
C'est pour moi une joie particulière de pouvoir exprimer ces pensées en hongrois, ma langue maternelle. Je suis né à Budapest, dans une famille juive, ma mère était originaire de Kolozsvár en Transylvanie, mon père, du sud-ouest du Balaton. Mes grands-parents allumaient encore les bougies le vendredi soir pour saluer le sabbat, mais ils avaient déjà changé leur nom pour lui donner une consonance hongroise et il était naturel pour eux d'avoir le judaïsme comme religion et de considérer la Hongrie comme leur patrie. Mes grands-parents maternels ont trouvé la mort durant l'Holocauste, mes grands-parents paternels ont été anéantis par le pouvoir communiste de Rákosi, après que la maison de retraite des Juifs a été transférée de Budapest vers la frontière du nord. Il me semble que cette brève histoire familiale résume et symbolise à la fois les souffrances récentes de ce pays. Tout cela m'apprend que le deuil ne recèle pas que de l'amertume, mais aussi des réserves morales extraordinaires. Etre juif : je pense qu'aujourd'hui, c'est redevenu avant tout un devoir moral. Si l'Holocauste a créé une culture - ce qui est incontestablement le cas - le but de celle-ci peut être seulement que la réalité irréparable enfante spirituellement la réparation, c'est-à-dire la catharsis. Ce désir a inspiré tout ce que j'ai jamais réalisé.
Bien que mon discours touche à sa fin, j'avoue sincèrement que je n'ai toujours pas trouvé d'équilibre apaisant entre ma vie, mon œuvre et le prix Nobel. Pour l'instant, je ne sens qu'une profonde reconnaissance - pour l'amour qui m'a sauvé et me maintient encore en vie. Mais admettons que dans le parcours à peine visible, la « carrière », si j'ose m'exprimer ainsi, qui est la mienne, il y a quelque chose de troublant, d'absurde ; une chose qu'on peut difficilement penser sans être tenté de croire en un ordre surnaturel, une providence, une justice métaphysique, c'est-à-dire sans se leurrer, et donc s'engager dans une impasse, se détruire et perdre le contact profond et douloureux avec les millions d'êtres qui sont morts et n'ont jamais connu la miséricorde. Il n'est pas simple d'être une exception ; et si le sort a fait de nous des exceptions, il faut se résigner à l'ordre absurde du hasard qui, pareil aux caprices d'un peloton d'exécution, règne sur nos vies soumises à des puissances inhumaines et à de terribles dictatures.
Pourtant, pendant que je préparais ce discours, il m'est arrivé une chose très étrange qui, en un certain sens, m'a rendu ma sérénité. Un jour, j'ai reçu par la poste une grande enveloppe en papier kraft. Elle m'avait été envoyée par le directeur du mémorial de Buchenwald, M. Volkhard Knigge. Il avait joint à ses cordiales félicitations une autre enveloppe, plus petite, dont il précisait le contenu, pour le cas où je n'aurais pas la force de l'affronter. A l'intérieur, il y avait une copie du registre journalier des détenus du 18 février 1945. Dans la colonne « Abgänge », c'est-à-dire « pertes », j'ai appris la mort du détenu numéro soixante-quatre mille neuf cent vingt et un, Imre Kertész, né en 1927, juif, ouvrier. Les deux données fausses, à savoir ma date de naissance et ma profession, s'expliquent par le fait que lors de leur enregistrement par l'administration du camp de concentration de Buchenwald, je m'étais vieilli de deux ans pour ne pas être mis parmi les enfants et avais prétendu être ouvrier plutôt que lycéen pour paraître plus utile.
Je suis donc mort une fois pour pouvoir continuer à vivre - et c'est peut-être là ma véritable histoire. Puisque c'est ainsi, je dédie mon œuvre née de la mort de cet enfant aux millions de morts et à tous ceux qui se souviennent encore de ces morts. Mais comme en définitive il s'agit de littérature, d'une littérature qui est aussi, selon l'argumentation de votre Académie, un acte de témoignage, peut-être sera-t-elle utile à l'avenir, et si j'écoutais mon cœur, je dirais même plus : elle servira l'avenir. Car j'ai l'impression qu'en pensant à l'effet traumatisant d'Auschwitz, je touche les questions fondamentales de la vitalité et de la créativité humaines ; et en pensant ainsi à Auschwitz, d'une manière peut-être paradoxale, je pense plutôt à l'avenir qu'au passé.
Avant toute chose, je dois vous faire un aveu, un aveu peut-être étrange mais sincère. Depuis que je suis monté dans l'avion pour venir ici, à Stockholm, recevoir le prix Nobel qui m'a été décerné cette année, je sens dans mon dos le regard scrutateur d'un observateur impassible ; et en cet instant solennel qui me place au centre de l'attention générale, je m'identifie plutôt à ce témoin imperturbable qu'à l'écrivain soudain révélé au monde entier. Et j'espère seulement que le discours que je vais prononcer pour cette occasion m'aidera à mettre fin à cette dualité, à réunir ces deux personnes qui vivent en moi.
Pour l'instant, moi-même, je ne comprends pas assez clairement l'aporie que je sens entre cette haute distinction et mon œuvre, ou plutôt ma vie. J'ai peut-être vécu trop longtemps dans des dictatures, dans un environnement intellectuel hostile et désespérément étranger, pour pouvoir prendre conscience de mon éventuelle valeur littéraire : la question ne valait tout simplement pas la peine d'être posée. De surcroît, on me faisait comprendre de toutes parts que le « sujet » qui occupait mes pensées, qui m'habitait, était dépassé et inintéressant. Voilà pourquoi(,) j'ai toujours considéré l'écriture comme une affaire strictement privée, ce qui rejoignait d'ailleurs mes plus intimes convictions.
Dire qu'il s'agit d'une affaire privée n'exclut nullement le sérieux, même si ce dernier semblait quelque peu ridicule dans un monde où seul le mensonge était pris au sérieux. Or, l'axiome philosophique définissait le monde comme réalité existant indépendamment de nous. Mais moi, en 1955, par un beau jour de printemps, j'ai compris d'un coup qu'il n'existait qu'une seule réalité, et que cette réalité, c'était moi, ma vie, ce cadeau fragile et d'une durée incertaine que des puissances étrangères et inconnues s'étaient approprié, avaient nationalisé, déterminé et scellé, et j'ai su que je devais la reprendre à ce monstrueux Moloch qu'on appelle l'histoire, car elle n'appartenait qu'à moi et je devais en disposer en tant que telle.
En tout cas, cela m'opposait radicalement à tout ce qui m'entourait, à cette réalité qui n'était peut-être pas objective, mais certainement indéniable. Je parle de la Hongrie communiste, du socialisme qui promettait un avenir radieux. Si le monde est une réalité objective qui existe indépendamment de nous, alors l'individu n'est qu'un objet - y compris pour lui-même, et l'histoire de sa vie n'est qu'une suite incohérente de hasards historiques qu'il peut certes contempler, mais qui ne le concernent pas. Il ne lui sert à rien de les ordonner en un ensemble cohérent, car son moi subjectif ne saurait assumer la responsabilité des éléments trop objectifs qui pourraient s'y trouver.
Un an plus tard, en 1956, a éclaté la révolution hongroise. Pour un seul et bref instant, le pays est devenu subjectif. Mais les chars soviétiques ont bien vite rétabli l'objectivité.
S'il vous semble que je fais de l'ironie, alors pensez, je vous prie, à ce que sont devenus la langue et les mots au cours du 20e siècle. Selon moi, il est vraisemblable que la plus importante, la plus bouleversante découverte des écrivains de notre temps est que la langue, telle que nous l'avons héritée d'une culture ancienne, est tout simplement incapable de représenter les processus réels, les concepts autrefois simples. Pensez à Kafka, pensez à Orwell qui ont vu la langue ancienne fondre dans leurs mains, comme s'ils l'avaient mise au feu pour ensuite en montrer les cendres où apparaissaient des images nouvelles et jusqu'alors inconnues.
Mais je voudrais revenir à mon affaire strictement personnelle, c'est-à-dire à l'écriture. Il y a là quelques questions que tout homme dans ma situation ne se pose même pas. Jean-Paul Sartre, par exemple, a consacré tout un opuscule à la question de savoir pour qui on écrit. La question est intéressante, mais elle peut également être dangereuse et je suis en tout cas reconnaissant à la vie de n'avoir jamais eu à y réfléchir. Voyons en quoi consiste le danger. Par exemple, si on vise une classe sociale qu'on voudrait non seulement divertir mais aussi influencer, il faut avant tout prendre en considération son propre style et se demander s'il est adapté à l'objectif qu'on s'est fixé. L'écrivain est bientôt assailli de doutes : le problème est qu'il est dès lors occupé à s'observer lui-même. De plus, comment pourrait-il savoir quelles sont les vraies attentes de son public, ce qui lui plaît vraiment ? Il ne peut tout de même pas interroger chaque individu. D'ailleurs, cela ne servirait à rien. En définitive, son seul point de départ possible est l'idée qu'il a lui-même de son public, les exigences que lui-même lui attribue, l'effet qu'aura sur lui-même l'influence qu'il souhaite exercer. Pour qui donc l'écrivain écrit-il ? La réponse est évidente : pour lui-même.
Moi au moins, je peux dire que j'étais arrivé à cette réponse sans aucun détour. Il est vrai que mon cas était plus simple : je n'avais pas de public et ne voulais influencer personne. Je n'avais pas de but précis quand j'ai commencé à écrire et ce que j'écrivais ne s'adressait à personne. Si mon écriture n'avait pas d'objectif clairement exprimable, elle consistait néanmoins à garder une fidélité formelle et linguistique à mon sujet, rien d'autre. Il importait de le préciser à cette époque ridicule mais triste où la littérature dite engagée était dirigée par l'Etat.
Il m'aurait en revanche été plus difficile de répondre à la question, posée à juste titre et non sans un certain scepticisme, de savoir pourquoi on écrit. A nouveau, j'ai eu de la chance, car je n'ai jamais eu l'occasion de trancher cette question. J'ai d'ailleurs relaté fidèlement cet événement dans mon roman intitulé Le refus. Je me trouvais dans le couloir désert d'un immeuble administratif et j'entendais des pas résonner dans un couloir perpendiculaire, c'est tout. J'ai été pris d'une sorte d'agitation particulière, les pas venaient dans ma direction, c'étaient ceux d'une seule personne que je ne voyais pas, et brusquement, j'ai eu l'impression d'en entendre marcher des centaines de milliers, une véritable colonne dont les pas retentissaient et alors j'ai saisi la force d'attraction de ce défilé, de ces pas. Là, dans ce couloir, j'ai compris en une seule seconde l'ivresse de l'abandon de soi, le plaisir vertigineux de se fondre dans la masse, ce que Nietzsche - dans un autre contexte, certes, mais avec pertinence - nomme l'extase dionysiaque. Une force quasi physique me poussait et m'attirait dans les rangs, je sentais que je devais m'appuyer et m'aplatir contre le mur, pour ne pas céder à cette attraction.
Je rends compte de cet instant intense comme je l'ai vécu ; la source d'où il avait jailli telle une vision semblait se trouver en dehors de moi et non en moi-même. Tout artiste connaît de tels instants. Autrefois, on les s'appelait des inspirations soudaines. Mais je ne mettrais pas ce que j'ai vécu au nombre des expériences artistiques. Je parlerais plutôt d'une prise de conscience existentielle, laquelle ne m'a pas donné la maîtrise de mon art, car j'ai dû encore longtemps en chercher les outils, mais celle de ma vie, alors que je l'avais presque perdue. Il y était question de la solitude, d'une vie plus difficile, de ce dont j'ai parlé au début : il s'agissait de sortir du cortège enivrant, de l'histoire qui dépouille l'homme de sa personnalité et de son destin. J'avais constaté avec effroi que dix ans après être revenu des camps nazis et avec pour ainsi dire un pied dans la fascination de la terreur stalinienne, il ne me restait plus de tout cela qu'une vague impression et quelques anecdotes. Comme si c'était arrivé à quelqu'un d'autre.
Il est évident que ces instants visionnaires ont une longue histoire que Sigmund Freud déduirait peut-être du refoulement de quelque traumatisme. Qui sait, peut-être aurait-il raison. Or moi aussi, je penche plutôt pour la rationalité et suis loin de tout mysticisme ou enthousiasme : quand je parle de vision, j'entends une réalité qui a pris la forme du surnaturel - à savoir la révélation soudaine, on pourrait dire révolutionnaire, d'une idée qui mûrissait en moi, une chose qu'exprime l'antique exclamation « eurêka ! ». « J'ai trouvé ! » Certes, mais quoi ?
J'ai dit un jour que pour moi, ce qu'on appelle le socialisme avait la même signification qu'eut pour Marcel Proust la madeleine qui, trempée dans le thé, avait ressuscité en lui les saveurs du temps passé. Après la défaite de la révolution de 1956, j'ai décidé, essentiellement pour des raisons linguistiques, de rester en Hongrie. Ainsi j'ai pu observer, non plus en tant qu'enfant, mais avec ma tête d'adulte, le fonctionnement d'une dictature. J'ai vu comment un peuple est amené à nier ses idéaux, j'ai vu les débuts de l'adaptation, les gestes prudents, j'ai compris que l'espoir était un instrument du mal et que l'impératif catégorique de Kant, l'éthique, n'étaient que les valets dociles de la subsistance.
Peut-on imaginer liberté plus grande que celle dont jouit un écrivain dans une dictature relativement limitée, pour ainsi dire fatiguée voire décadente ? Dans les années soixante, la dictature hongroise était arrivée à un point de consolidation qu'on peut appeler consensus social et auquel le monde occidental donnerait plus tard, avec condescendance, le petit nom de « communisme de goulache » : après l'animosité du début, le communisme hongrois était devenu d'un coup le communisme préféré de l'Occident. Dans le bourbier de ce consensus, il ne restait qu'une alternative : ou bien renoncer définitivement au combat, ou bien chercher les chemins tortueux de la liberté intérieure. Un écrivain n'a pas de grands besoins, un crayon et du papier suffisent à l'exercice de son art. Le dégoût et la dépression avec lesquels je me réveillais chaque matin m'introduisaient vite dans le monde que je voulais décrire. Je me suis rendu compte que je décrivais un homme broyé par la logique d'un totalitarisme en vivant moi-même dans un autre totalitarisme, et cela a sans aucun doute fait de la langue de mon roman un moyen de communication suggestif. Si j'évalue en toute sincérité ma situation à cette époque-là, je ne sais pas si en Occident, dans une société libre, j'aurais été capable d'écrire le même roman que celui qui est connu aujourd'hui sous le titre d'Etre sans destin et qui a obtenu la plus haute distinction de l'Académie Suédoise.
Non, car j'aurais certainement eu d'autres préoccupations. Je n'aurais certes pas renoncé à chercher la vérité, mais c'eût été peut-être une autre vérité. Dans le marché libre des livres et des esprits, je me serais peut-être efforcé de trouver une forme romanesque plus brillante : j'aurais pu, par exemple, fragmenter la narration pour ne raconter que les moments frappants. Sauf que dans les camps de concentration, mon héros ne vit pas son propre temps, puisqu'il est dépossédé de son temps, de sa langue, de sa personnalité. Il n'a pas de mémoire, il est dans l'instant. Si bien que le pauvre doit dépérir dans le piège morne de la linéarité et ne peut se libérer des détails pénibles. Au lieu d'une succession spectaculaire de grands moments tragiques, il doit vivre le tout, ce qui est pesant et offre peu de variété, comme la vie.
Mais cela m'a permis de tirer des enseignements étonnants. La linéarité exige que chaque situation s'accomplisse intégralement. Elle m'a interdit, par exemple, de sauter élégamment une vingtaine de minutes pour la seule raison que ces vingt minutes béaient devant moi tel un gouffre noir, inconnu et effrayant comme une fosse commune. Je parle de ces vingt minutes qui se sont écoulées sur le quai du camp d'extermination de Birkenau avant que les personnes descendues des wagons ne se retrouvent devant l'officier qui faisait la sélection. Moi-même, j'avais un souvenir approximatif de ces vingt minutes, mais le roman m'interdisait de me fier à mes réminiscences. Presque tous les témoignages, confessions et souvenirs de survivants que j'avais lus étaient d'accord sur le fait que tout s'était déroulé très vite et dans la plus grande confusion : les portes des wagons s'ouvraient violemment au milieu des cris et des aboiements, les hommes étaient séparés des femmes, dans une cohue démentielle ils se retrouvaient devant un officier qui leur jetait un rapide coup d'œil, montrait quelque chose en tendant le bras, puis ils se retrouvaient en tenue de prisonnier.
Moi, j'avais un autre souvenir de ces vingt minutes. En cherchant des sources authentiques, j'ai commencé par lire Tadeusz Borowski, ses récits limpides, d'une cruauté masochiste, dont celui qui s'intitule « Au gaz, messieurs-dames ! » Ensuite, j'ai eu entre les mains une série de photos qu'un SS avait prises sur le quai de Birkenau lors de l'arrivée des convois et que les soldats américains ont retrouvées à Dachau, dans l'ancienne caserne des SS. J'ai été sidéré par ces photos : beaux visages souriants de femmes, de jeunes hommes au regard intelligent, pleins de bonne volonté, prêts à coopérer. Alors j'ai compris comment et pourquoi ces vingt minutes humiliantes d'inaction et d'impuissance s'étaient estompées dans leur mémoire. Et quand en pensant que tout cela s'était répété jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, durant de longues années, j'ai pu entrevoir la technique de l'horreur, j'ai compris comment on pouvait retourner la nature humaine contre la vie humaine.
J'avançais ainsi, pas à pas, sur la voie linéaire des découvertes ; c'était, si on veut, ma méthode heuristique. J'ai vite compris que les questions de savoir pour qui et pour quoi j'écrivais ne m'intéressaient pas. Une seule question me travaillait : qu'avais-je encore en commun avec la littérature ? Car il était clair qu'une ligne infranchissable me séparait de la littérature et de ses idéaux, de son esprit, et cette ligne - comme tant d'autres choses - s'appelle Auschwitz. Quand on écrit sur Auschwitz, il faut savoir que, du moins dans un certain sens, Auschwitz a mis la littérature en suspens. A propos d'Auschwitz, on ne peut écrire qu'un roman noir ou, sauf votre respect, un roman-feuilleton dont l'action commence à Auschwitz et dure jusqu'à nos jours. Je veux dire par là qu'il ne s'est rien passé depuis Auschwitz qui ait annulé Auschwitz, qui ait réfuté Auschwitz. Dans mes écrits, l'Holocauste n'a jamais pu apparaître au passé.
On dit à mon propos - pour m'en féliciter ou pour me le reprocher - que je suis l'écrivain d'un seul thème, l'Holocauste. Je ne trouve rien à y redire, pourquoi n'accepterais-je pas, avec quelques réserves, la place qui m'a été attribuée sur l'étagère idoine des bibliothèques ? En effet, quel écrivain aujourd'hui n'est pas un écrivain de l'Holocauste ? Je veux dire qu'il n'est pas nécessaire de choisir expressément l'Holocauste comme sujet pour remarquer la dissonance qui règne depuis des décennies dans l'art contemporain en Europe. De plus : il n'y a, à ma connaissance, pas d'art valable ou authentique où on ne sente pas la cassure qu'on éprouve en regardant le monde après une nuit de cauchemars, brisé et perplexe. Je n'ai jamais eu la tentation de considérer les questions relatives à l'Holocauste comme un conflit inextricable entre les Allemands et les Juifs ; je n'ai jamais cru que c'était l'un des chapitres du martyre juif qui succède logiquement aux épreuves précédentes ; je n'y ai jamais vu un déraillement soudain de l'histoire, un pogrome d'une ampleur plus importante que les autres ou encore les conditions de la fondation d'un Etat juif. Dans l'Holocauste, j'ai découvert la condition humaine, le terminus d'une grande aventure où les Européens sont arrivés au bout de deux mille ans de culture et de morale.
A présent il faut réfléchir au moyen d'aller plus loin. Le problème d'Auschwitz n'est pas de savoir s'il faut tirer un trait dessus ou non, si nous devons en garder la mémoire ou plutôt le jeter dans le tiroir approprié de l'histoire, s'il faut ériger des monuments aux millions de victimes et quel doit être ce monument. Le véritable problème d'Auschwitz est qu'il a eu lieu, et avec la meilleure ou la plus méchante volonté du monde, nous ne pouvons rien y changer. En parlant de « scandale », le poète hongrois catholique János Pilinszky a sans doute trouvé la meilleure dénomination de ce pénible état de fait ; et par là, il voulait à l'évidence dire qu'Auschwitz a eu lieu dans la culture chrétienne et constitue ainsi pour un esprit métaphysique une plaie ouverte.
D'anciennes prophéties disent que Dieu est mort. Il ne fait aucun doute, qu'après Auschwitz, nous sommes restés livrés à nous-mêmes. Il nous a fallu créer nos valeurs, jour après jour, par un travail éthique opiniâtre mais invisible qui finira par produire les valeurs qui donneront peut-être naissance à la nouvelle culture européenne. Que l'Académie Suédoise ait jugé bon de distinguer précisément mon œuvre prouve à mes yeux que l'Europe éprouve à nouveau le besoin que les survivants d'Auschwitz et de l'Holocauste lui rappellent l'expérience qu'ils ont été obligés d'acquérir. A mes yeux, permettez-moi de le dire, c'est une marque de courage, voire d'une certaine détermination ; car on a souhaité me voir venir ici tout en se doutant de ce que j'allais dire. Mais ce qui a été révélé à travers la solution finale et « l'univers concentrationnaire » ne peut pas prêter à confusion, et la seule possibilité de survivre, de conserver des forces créatrices est de découvrir ce point zéro. Pourquoi cette lucidité ne serait-elle pas fertile ? Au fond des grandes découvertes, même si elles se fondent sur des tragédies extrêmes, réside toujours la plus admirable valeur européenne, à savoir le frémissement de la liberté qui confère à notre vie une certaine plus-value, une certaine richesse en nous faisant prendre conscience de la réalité de notre existence et de notre responsabilité envers celle-ci.
C'est pour moi une joie particulière de pouvoir exprimer ces pensées en hongrois, ma langue maternelle. Je suis né à Budapest, dans une famille juive, ma mère était originaire de Kolozsvár en Transylvanie, mon père, du sud-ouest du Balaton. Mes grands-parents allumaient encore les bougies le vendredi soir pour saluer le sabbat, mais ils avaient déjà changé leur nom pour lui donner une consonance hongroise et il était naturel pour eux d'avoir le judaïsme comme religion et de considérer la Hongrie comme leur patrie. Mes grands-parents maternels ont trouvé la mort durant l'Holocauste, mes grands-parents paternels ont été anéantis par le pouvoir communiste de Rákosi, après que la maison de retraite des Juifs a été transférée de Budapest vers la frontière du nord. Il me semble que cette brève histoire familiale résume et symbolise à la fois les souffrances récentes de ce pays. Tout cela m'apprend que le deuil ne recèle pas que de l'amertume, mais aussi des réserves morales extraordinaires. Etre juif : je pense qu'aujourd'hui, c'est redevenu avant tout un devoir moral. Si l'Holocauste a créé une culture - ce qui est incontestablement le cas - le but de celle-ci peut être seulement que la réalité irréparable enfante spirituellement la réparation, c'est-à-dire la catharsis. Ce désir a inspiré tout ce que j'ai jamais réalisé.
Bien que mon discours touche à sa fin, j'avoue sincèrement que je n'ai toujours pas trouvé d'équilibre apaisant entre ma vie, mon œuvre et le prix Nobel. Pour l'instant, je ne sens qu'une profonde reconnaissance - pour l'amour qui m'a sauvé et me maintient encore en vie. Mais admettons que dans le parcours à peine visible, la « carrière », si j'ose m'exprimer ainsi, qui est la mienne, il y a quelque chose de troublant, d'absurde ; une chose qu'on peut difficilement penser sans être tenté de croire en un ordre surnaturel, une providence, une justice métaphysique, c'est-à-dire sans se leurrer, et donc s'engager dans une impasse, se détruire et perdre le contact profond et douloureux avec les millions d'êtres qui sont morts et n'ont jamais connu la miséricorde. Il n'est pas simple d'être une exception ; et si le sort a fait de nous des exceptions, il faut se résigner à l'ordre absurde du hasard qui, pareil aux caprices d'un peloton d'exécution, règne sur nos vies soumises à des puissances inhumaines et à de terribles dictatures.
Pourtant, pendant que je préparais ce discours, il m'est arrivé une chose très étrange qui, en un certain sens, m'a rendu ma sérénité. Un jour, j'ai reçu par la poste une grande enveloppe en papier kraft. Elle m'avait été envoyée par le directeur du mémorial de Buchenwald, M. Volkhard Knigge. Il avait joint à ses cordiales félicitations une autre enveloppe, plus petite, dont il précisait le contenu, pour le cas où je n'aurais pas la force de l'affronter. A l'intérieur, il y avait une copie du registre journalier des détenus du 18 février 1945. Dans la colonne « Abgänge », c'est-à-dire « pertes », j'ai appris la mort du détenu numéro soixante-quatre mille neuf cent vingt et un, Imre Kertész, né en 1927, juif, ouvrier. Les deux données fausses, à savoir ma date de naissance et ma profession, s'expliquent par le fait que lors de leur enregistrement par l'administration du camp de concentration de Buchenwald, je m'étais vieilli de deux ans pour ne pas être mis parmi les enfants et avais prétendu être ouvrier plutôt que lycéen pour paraître plus utile.
Je suis donc mort une fois pour pouvoir continuer à vivre - et c'est peut-être là ma véritable histoire. Puisque c'est ainsi, je dédie mon œuvre née de la mort de cet enfant aux millions de morts et à tous ceux qui se souviennent encore de ces morts. Mais comme en définitive il s'agit de littérature, d'une littérature qui est aussi, selon l'argumentation de votre Académie, un acte de témoignage, peut-être sera-t-elle utile à l'avenir, et si j'écoutais mon cœur, je dirais même plus : elle servira l'avenir. Car j'ai l'impression qu'en pensant à l'effet traumatisant d'Auschwitz, je touche les questions fondamentales de la vitalité et de la créativité humaines ; et en pensant ainsi à Auschwitz, d'une manière peut-être paradoxale, je pense plutôt à l'avenir qu'au passé.
 NadejdaGrand sage
NadejdaGrand sage
Au-delà du thème de l'Holocauste, je trouve cet homme admirable de courage dans sa ténacité à avoir fait de sa vie un destin d'écrivain.
 JPhMMDemi-dieu
JPhMMDemi-dieu
Superbe. Un texte très riche. Par exemple, ses mots extrêmement puissants sur la linéarité sont un trésor.Nadejda a écrit:Eurêka ! (par Imre Kertész)
[...] je pense plutôt à l'avenir qu'au passé.
Merci Nadejda.
_________________
Labyrinthe où l'admiration des ignorants et des idiots qui prennent pour savoir profond tout ce qu'ils n'entendent pas, les a retenus, bon gré malgré qu'ils en eussent. — John Locke
Je crois que je ne crois en rien. Mais j'ai des doutes. — Jacques Goimard
 JPhMMDemi-dieu
JPhMMDemi-dieu
Tchouang-tseu, L'Œuvre complète, chapitre II « La réduction ontologique », traduit par Liou Kia-hway et Paul Demiéville.Supposons qu'on émette ici un jugement. Sait-on jamais s'il ressemble aux préjugés humains ? ou au contraire s'il ne leur ressemble point ? Qu'il leur ressemble ou qu'il ne leur ressemble pas, ce jugement et les préjugés humains participent à un même genre, ainsi ce jugement ne diffère pas de ceux-ci. Essayons d'illustrer notre affirmation générale par un exemple. Quelqu'un soutient que le monde a un commencement; un autre nie qu'il y ait un commencement du monde; un autre nie la thèse d'après laquelle un autre nie qu'il y ait un commencement du monde. En d'autres termes, quelqu'un soutient qu'il y a l'être à l'origine du monde; un autre soutient que le néant se trouve à l'origine du monde; un autre nie la thèse d'après laquelle le néant se trouve à l'origine du monde; un autre nie de nouveau la thèse selon laquelle un autre nie que le néant se trouve à l'origine du monde. Tantôt il y a l'être, tantôt il y a le néant. Sait-on jamais si l'être et le néant existent vraiment ou n'existent pas vraiment ? Si j'émets ici un jugement sait-on jamais si celui-ci est jugement ou l'absence de tout jugement ?
_________________
Labyrinthe où l'admiration des ignorants et des idiots qui prennent pour savoir profond tout ce qu'ils n'entendent pas, les a retenus, bon gré malgré qu'ils en eussent. — John Locke
Je crois que je ne crois en rien. Mais j'ai des doutes. — Jacques Goimard
 JPhMMDemi-dieu
JPhMMDemi-dieu
Puisqu'il pleut...

SOUS LA PLUIE
Il y a pourtant assez de maux réels ; cela n’empêche pas que les gens y ajoutent, par une sorte d’entraînement de l’imagination. Vous rencontrez tous les jours un homme au moins qui se plaindra du métier qu’il fait, et ses discours vous paraîtront toujours assez forts, car il y a à dire sur tout, et rien n’est parfait.
Vous, professeur, vous avez, dites-vous, à instruire de jeunes brutes qui ne savent rien et qui ne s’intéressent à rien ; vous, ingénieur, vous êtes plongé dans un océan de paperasses ; vous, avocat, vous plaidez devant des juges qui digèrent en somnolant, au lieu de vous écouter. Ce que vous dites est sans doute vrai, et je le prends pour tel ; ces choses-là sont toujours assez vraies pour qu’on puisse les dire. Si avec cela vous avez un mauvais estomac, ou des chaussures qui prennent l’eau, je vous comprends très bien ; voilà de quoi maudire la vie, les hommes, et même Dieu si vous croyez qu’il existe.
Cependant, remarquez une chose, c’est que cela est sans fin, et que tristesse engendre tristesse. Car, à vous plaindre ainsi de la destinée, vous augmentez vos maux, vous vous enlevez d’avance tout espoir de rire, et votre estomac lui-même s’en trouve encore plus mal. Si vous aviez un ami, et s’il se plaignait amèrement de toutes choses, vous essaieriez sans doute de le calmer et de lui faire voir le monde sous un autre aspect. Pourquoi ne seriez-vous pas un précieux ami pour vous-même ? Mais oui, sérieusement, je dis qu’il fait s’aimer un peu et être bon avec soi. Car tout dépend souvent d’une première attitude que l’on prend. Un auteur ancien a dit que tout événement a deux anses, et qu’il n’est pas sage de choisir pour le porter celle qui blesse la main. Le commun langage a toujours nommé philosophes ceux qui choisissent en toute occasion le meilleur discours et le plus tonique ; c’est viser au centre. Il s’agit donc de plaider pour soi, non contre soi. Nous sommes tous si bons plaideurs, et si entraînants, que nous saurons bien trouver des raisons d’être contents, si nous prenons ce chemin-là. J’ai souvent observé que c’est par inadvertance, et un peu aussi par politesse, que les hommes se plaignent de leur métier. Si on les incline à parler de ce qu’ils font et de ce qu’ils inventent, non de ce qu’ils subissent, les voilà poètes, et joyeux poètes.
Voici une petite pluie ; vous êtes dans la rue, vous ouvrez votre parapluie ; c’est assez. A quoi bon dire : « Encore cette sale pluie ! » ; cela ne leur fait rien du tout aux gouttes d’eau, ni au nuage ni au vent. Pourquoi ne dites-vous pas aussi bien : « Oh ! la bonne petite pluie ! » Je vous entends, cela ne fera rien du tout aux gouttes d’eau ; c’est vrai. Mais cela vous sera bon à vous ; tout votre corps se secouera, s’échauffera, car tel est l’effet du plus petit mouvement de joie ; et vous voilà comme il faut être pour recevoir la pluie sans prendre un rhume.
Et prenez aussi les hommes comme la pluie. Cela n’est pas facile, dites-vous. Mais si : c’est bien plus facile que pour la pluie. Car votre sourire ne fait rien à la pluie, mais il fait beaucoup aux hommes et, simplement par imitation, il les rend déjà moins tristes et moins ennuyeux. Sans compter que vous leur trouverez aisément des excuses, si vous regardez en vous. Marc-Aurèle disait tous les matins : « Je vais rencontrer aujourd’hui un vaniteux, un menteur, un injuste, un ennuyeux bavard ; ils sont ainsi à cause de leur ignorance. »
4 novembre 1907

_________________
Labyrinthe où l'admiration des ignorants et des idiots qui prennent pour savoir profond tout ce qu'ils n'entendent pas, les a retenus, bon gré malgré qu'ils en eussent. — John Locke
Je crois que je ne crois en rien. Mais j'ai des doutes. — Jacques Goimard
 Marie LaetitiaBon génie
Marie LaetitiaBon génie
ces textes donnent envie de consacrer au moins une demie-heure par jour à ces belles oeuvres, pour ne pas vivre en vain... Merci JPhMM...
_________________

Si tu crois encore qu'il nous faut descendre dans le creux des rues pour monter au pouvoir, si tu crois encore au rêve du grand soir, et que nos ennemis, il faut aller les pendre... Aucun rêve, jamais, ne mérite une guerre. L'avenir dépend des révolutionnaires, mais se moque bien des petits révoltés. L'avenir ne veut ni feu ni sang ni guerre. Ne sois pas de ceux-là qui vont nous les donner (J. Brel, La Bastille)
Antigone, c'est la petite maigre qui est assise là-bas, et qui ne dit rien. Elle regarde droit devant elle. Elle pense. [...] Elle pense qu'elle va mourir, qu'elle est jeune et qu'elle aussi, elle aurait bien aimé vivre. Mais il n'y a rien à faire. Elle s'appelle Antigone et il va falloir qu'elle joue son rôle jusqu'au bout...
Et on ne dit pas "voir(e) même" mais "voire" ou "même".
 JPhMMDemi-dieu
JPhMMDemi-dieu
Même ouvrage.
Ce livre est une merveille.
LES MÉCHANTS (extrait)
Quand je parle des méchants, je n'entends pas, comme on voit, des espèces de diables rusés qui feraient les hypocrites ; j'entends les violents, tous ceux qui s'abandonnent à leurs passions, tous ceux qui jugent ingénument d'après leurs désirs, et qui sans cesse forcent les autres, sans s'en douter, et même en criant de bonne foi que personne n'a d'égards pour eux. La force des méchants, c'est qu'ils se croient bons, et victimes des caprices d'autrui. Aussi parlent-ils toujours de leurs droits, et invoquent-ils perpétuellement la justice ; toujours visant le bien à les entendre ; toujours pensant aux autres, comme ils disent ; toujours étalant leurs vertus, toujours faisant la leçon, et de bonne foi. Ces accents, ces discours passionnés, ces plaidoyers pleins de mouvement et de feu accablent les natures pacifiques et justes. Les braves gens n'ont jamais une conscience si assurée ; ils n'ont point ce feu intérieur qui éclaire les mauvaises preuves ; ils savent douter et examiner ; et, quand ils décident à leur propre avantage, cela les inquiète toujours un peu. Bien loin de demander avec fureur, ils sont assez contents si on leur laisse ce qu'ils ont ; ils accorderaient tout pour avoir la paix, et ils n'ont point la paix. On tire sur leur vertu comme sur une corde. Le méchant leur dit : « Vous qui êtes bon, juste et généreux. » Les braves gens voudraient bien être tout cela ; ils trouvent qu'ils n'y arrivent guère. L'éloge leur plaît autant qu'à d'autres ; mais le blâme les touche à vif, parce qu'ils sont trop portés à se blâmer eux-mêmes, et à grossir leurs plus petites fautes. Ainsi l'on a deux moyens de les conduire.
Ajoutons aussi qu'ils sont indulgents, qu'ils comprennent les violents, qu'ils les plaignent, qu'ils leur pardonnent ; et qu'enfin ils portent en eux un principe de faiblesse et d'esclavage ; ils sont heureux. Ils se consolent, ils se résignent. Enfants, ils jouent dans un coin avec un bouchon qu'on leur a laissé. Hommes, ils savent encore se plaire à des biens dont les autres ne veulent pas, ce qui fait qu'ils oublient trop vite le mal qu'on leur a fait. Ce n'est pas une petite ressource que la mauvaise humeur ; et c'est sans doute pour cela que les bilieux conviennent pour la politique ; ils sont craints, et, chose singulière, ils sont aimés dès qu'ils ne font pas tout le mal possible ; un sourire de leur part, un compliment, un mouvement de bienveillance sont reçus comme des grâces. On n'est point fier de plaire à un brave homme, au lieu que l'on travaille à faire sourire un enfant maussade. Le plaisant, c'est que le méchant qui lira ces lignes se dira à lui-même qu'il est bon, tandis que le bon se demandera s'il n'est pas en effet bien méchant. Ainsi ce discours, qui vise les méchants, n'atteint que les bons.
15 octobre 1911.
Ce livre est une merveille.
_________________
Labyrinthe où l'admiration des ignorants et des idiots qui prennent pour savoir profond tout ce qu'ils n'entendent pas, les a retenus, bon gré malgré qu'ils en eussent. — John Locke
Je crois que je ne crois en rien. Mais j'ai des doutes. — Jacques Goimard
 InfinimentHabitué du forum
InfinimentHabitué du forum
Soirée inquiète et mélancolique, donc je fais remonter ce fil. J'ai feuilleté quelques pages de Jacqueline de Romilly, car un peu de bon sens et de lucidité toujours actuelle m'était nécessaire. Je vous fais profiter de quelques extraits choisis. Puissent-ils vous apporter autant de réconfort qu'à moi...
Mais quoi ? Qu'y aurait-il alors ? Et quel sort m'attendait là ? Je ne le savais pas : pour l'instant, je n'étais pas morte. Je n'étais pas morte, et je pouvais encore, bien qu'avec peine, travailler, continuer, admirer, et essayer de faire pour le mieux. […] Les voix d'Homère ou de Thucydide, auxquelles j'avais tant prêté d'attention, et peut-être trop, gardaient toute leur force et tout leur relief, après avoir traversé tant et tant de générations. Tout ne s'use pas, tout ne disparaît pas. Peut-être en est-il ainsi, de quelque façon, pour nos vies elles-mêmes.
Les roses de la solitude
Quand je pense à [la] mort d'Achille, malgré le chagrin des chevaux, je ne suis nullement triste ; je trouve plutôt la confirmation de ce que je voudrais toujours croire : l'homme, avec toutes ses limites et ses imperfections, peut être admirable. Il peut réagir comme nous l'espérions et mieux que nous ne l'espérions, il peut être une présence à la fois amie et infiniment supérieure ; on peut donc nous faire sentir, tout à la fois, que nous allons mourir, mais que la vie est belle.
Tout cela, qui me remplit d'émoi, n'est que l'oeuvre du poète et de la littérature. Mais après tout j'en ai vécu, de la littérature : et pourquoi n'en vivrait-on pas ? Il n'est pas plus éclatant témoignage. Alors je regarde mes petits chevaux de bronze : cet obscur contentement, que, sur le moment, je n'analyse pas, est en fait une double confiance dans la littérature et surtout dans l'homme.
Les roses de la solitude
On admet en général que les anciens Grecs s'attachaient plus à ce qui reste qu'à ce qui change, à la permanence qu'à l'évolution. On leur a même prêté volontiers des doctrines comme celle du temps cyclique et de l'éternel retour. En cela, on a fort exagéré. Mais il est vrai qu'ils aimaient l'idée d'un « cosmos », d'un univers en ordre, dans lequel le temps présiderait à des alternances régulières plutôt qu'à un progrès ouvert ou à de perpétuelles transformations.
[…] Il y a dans la structure même de la tragédie quelque chose qui, dans une certaine mesure est un refus du temps […]. La crise tragique se relâche, elle aussi, à intervalles réguliers, pour laisser place aux chants du chœur.
Ces coupures […] signifient qu'il y a rémission et alternance. Épisodes et parties chantées se succèdent et se répondent, comme les métopes et les triglyphes dans une frise dorique. L'ensemble acquiert ainsi une sorte d'harmonie intérieure, […] suggérant un arrangement aussi ordonné que celui qui préside à l'enchaînement des jours et des nuits, de l'été et de l'hiver. À cet égard, on peut dire que cette structure, qui est propre à la tragédie grecque, n'est pas sans s'accorder avec une vision du temps pour laquelle les difficultés humaines ne parviennent pas à rompre l'éternelle harmonie du monde.
Le temps dans la tragédie grecque
Je les ai tant guettés, ces printemps à leurs débuts. Après, dans la folle explosion de la belle saison, quand tout sera donné ensemble, à foison, le sentiment ne sera plus le même ; il suffira alors de se laisser vivre, comblé par le présent. Il faut donc me pardonner si je n'ai pu évoquer les premières apparitions qu'une à une ; chacune, dans sa rareté, et son unicité, portait en elle-même le miracle du renouveau.
Je pense aussi que d'avoir tant guetté ces floraisons, d'année en année, me les rend plus précieuses. J'ai parlé de miracle ; mais c'est un miracle à date fixe, dont le retour combine la douceur des surprises et celle de l'habitude. Il en va comme des gens que l'on aime. J'ai appris très tard quelle joie ce pouvait être que de les reconnaître dans chacun de leurs mots ou de leurs gestes, sans plus chercher à faire de différence entre ce qui est bien ou mal, agréable ou désagréable : c'est lui, ou c'est elle ; et cela suffit pour que l'on s'enchante de les retrouver, fidèlement, à tout moment. De même, dans mes collines, ces retours du printemps sont toujours mon printemps d'avant et de toujours.
Sur les chemins de Sainte-Victoire
Je suis sortie de l'église, dont la sobre flèche de pierre ocre s'élevait, lumineuse, dans un ciel tout clair ; et je me suis dit : Quelle chance ! Tous ces désastres n'ont pas encore eu lieu. La place est là, dans le soleil. Et nous avons au moins obtenu un sursis : une chance de plus pour tenter d'agir, une chance de plus pour nous racheter, une chance de plus pour vivre !
La flèche brillait de toute la dignité patinée du passé ; des touristes très modernes erraient sur la petite place, avec les oiseaux de toujours. Alors, tous ces débats m'ont semblé tout à coup bien abstraits et bien superflus. Je savais : c'était si simple ! Il suffisait de se rappeler que, entre hier et demain, les ponts ne peuvent jamais être coupés. Entre les deux, à la jonction, nourri de l'un et gros de l'autre, il y a, comme un gage de notre liberté et une invitation à mieux vivre — ô merveille des merveilles —, il y a aujourd'hui.
Cela ne paraîtra pas très original. Mais je ne suis pas originale. Je vous raconte une histoire vraie. Et — j'allais oublier de le dire — je crois, avant tout et toujours, en la vérité.
Ce que je crois
_________________
Ah ! la belle chose, que de savoir quelque chose !
Page 2 sur 4 •  1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 4 
 1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 4 
- Quelles thématiques pour les lectures cursives en 3e
- Quelles lectures cursives pour vos élèves ?
- Quelles lectures cursives pour la classe de Seconde?
- Quelles lectures cursives pour l'autobiographie et le récit d'enfance?
- Quelles lectures littéraires sur le thème du commerce pour un public a priori pas trop lecteur en lycée ?
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum


