Page 1 sur 2 • 1, 2 

 MamaVénérable
MamaVénérable
Bonjour !
Tout est dans le titre !
Je crois que ce thème n'a pas encore été proposé dans cette rubrique : dites-moi si je me trompe ?
Quel plaisir de découvrir les mots choisis par les uns et les autres, parce qu'ils expriment merveilleusement nos perceptions confuses, nos états d'âme, nos souvenirs, nos aspirations, nos inconnus...
Je commence (un seul texte à la fois) avec le célèbre incipit de Que ma joie demeure de Jean Giono, qui me renverse, littéralement, chaque fois que je le lis. Magie pure de la langue et de l'instant. Celle de mes nuits blanches d'été, en forêt, dans le Sud, tout à coup dicible.
"C'était une nuit extraordinaire.
Il y avait eu du vent, il avait cessé, et les étoiles avaient éclaté comme de l'herbe. Elles étaient en touffes avec des racines d'or, épanouies, enfoncées dans les ténèbres et qui soulevaient des mottes luisantes de nuit.
Jourdan ne pouvait pas dormir. Il se tournait, il se retournait.
«Il fait un clair de toute beauté», se disait-il.
Il n'avait jamais vu ça.
Le ciel tremblait comme un ciel de métal. On ne savait pas de quoi puisque tout était immobile, même le plus petit pompon d'osier. Ça n'était pas le vent. C'était tout simplement le ciel qui descendait jusqu'à toucher la terre, racler les plaines, frapper les montagnes et faire sonner les corridors des forêts. Après, il remontait au fond des hauteurs."
C'est à vous !
Tout est dans le titre !
Je crois que ce thème n'a pas encore été proposé dans cette rubrique : dites-moi si je me trompe ?
Quel plaisir de découvrir les mots choisis par les uns et les autres, parce qu'ils expriment merveilleusement nos perceptions confuses, nos états d'âme, nos souvenirs, nos aspirations, nos inconnus...
Je commence (un seul texte à la fois) avec le célèbre incipit de Que ma joie demeure de Jean Giono, qui me renverse, littéralement, chaque fois que je le lis. Magie pure de la langue et de l'instant. Celle de mes nuits blanches d'été, en forêt, dans le Sud, tout à coup dicible.
"C'était une nuit extraordinaire.
Il y avait eu du vent, il avait cessé, et les étoiles avaient éclaté comme de l'herbe. Elles étaient en touffes avec des racines d'or, épanouies, enfoncées dans les ténèbres et qui soulevaient des mottes luisantes de nuit.
Jourdan ne pouvait pas dormir. Il se tournait, il se retournait.
«Il fait un clair de toute beauté», se disait-il.
Il n'avait jamais vu ça.
Le ciel tremblait comme un ciel de métal. On ne savait pas de quoi puisque tout était immobile, même le plus petit pompon d'osier. Ça n'était pas le vent. C'était tout simplement le ciel qui descendait jusqu'à toucher la terre, racler les plaines, frapper les montagnes et faire sonner les corridors des forêts. Après, il remontait au fond des hauteurs."
C'est à vous !
 VicomteDeValmontGrand sage
VicomteDeValmontGrand sage
Deux descriptions d'un même lieu dans Dans le ciel d'Octave Mirbeau:
Dans le ciel, Mirbeau a écrit:X... habite une ancienne abbaye, perchée au sommet d'un pic. Mais pourquoi dans ce pays de tranquilles plaines, où nulle autre convulsion de sol ne s'atteste, pourquoi ce pic a-t-il jailli de la terre, énorme et paradoxal cône solitaire ? La destinée bizarre de mon ami devait, par une inexplicable ironie, l'amener dans ce paysage spécial, et comme il n'en existe peut-être pas un autre nulle part. Cela me parut déjà bien mélancolique. De l'abbaye, il ne reste qu'une sorte de maison, ou plutôt, d'orangerie, basse et longue, surajoutée sous Louis XIV, au bâtiment principal, dont les quatre murs, croulants, retenus dans leur chute par une couche épaisse de lierre, seuls, demeurent. En dépit de sa retraite, et de l'état d'abandon où la laisse son propriétaire, la maison est charmante, avec ses fenêtres hautes, son large perron, et son toit mansardé, que décorent des mousses étrangement vertes. Tout autour, des pelouses libres où se croisent des allées de tilleuls, des parterres fleuris de fleurs sauvages, des citernes qui, dans les broussailles, ouvrent des yeux profonds et verdâtres, des terrasses ombrées de charmilles et de grands arbres, de grands massifs d'arbres qui font sur le ciel des colonnades, des routes ogivales, de splendides trouées sur l'infini. Et l'on semble perdu dans ce ciel, emporté dans ce ciel, un ciel immense, houleux comme une mer, un ciel fantastique, où sans cesse de monstrueuses formes, d'affolants faunes, d'indescriptibles flores, des architectures de cauchemar, s'élaborent, vagabondent et disparaissent... Pour s'arracher à ce grand rêve du ciel qui vous entoure d'éternité silencieuse, pour apercevoir la terre vivante et mortelle, il faut aller au bord des terrasses, il faut se pencher, presque, au bord des terrasses. Au pied du pic coule une rivière traversée d'un barrage que frange d'écume l'eau bouillonnante. Deux écluses dorment dans leurs cuves de pierre ; deux chalands s'amarrent au quai. Sur le chemin de halage, quelques maisons s'échelonnent, quelques hangars dont on ne voit que les toits plats et roses. Et, par-delà la rivière s'étendent des plaines, des plaines, des plaines, des plaines ondulées de vallonnements, où sont des villages, tout petits et naïfs, à peine visibles, des églises gauches, enfantines, des églises et des villages perdus comme des nids d'alouettes. À l'horizon, des traits minces figurent des forêts. Mais la vue ne descend des célestes terrasses, n'arrive au paysage terrestre qu'à travers le vertige de l'abîme.
Dans le ciel, Mirbeau a écrit:Figure-toi un pic, tout ras, un pic cocasse, en forme de pain de sucre. Au sommet, quelques arbres qui ont chétivement poussé, et dont les branches s'ornementent de jolies torsions décoratives. Dans ces arbres une vieille maison croulante que les lierres, seuls, retiennent. Et tout autour de cela, le ciel, le ciel, un ciel immense, à perte de rêve. Eh bien, ce pain de sucre, cette maison, ce ciel, tout cela est à moi. J'en suis depuis hier, à onze heures et demie, le propriétaire étonné et ravi. Voilà donc le grand mystère dévoilé !
Cet événement considérable s'est accompli sans trop d'anicroches. Le gîte était à vendre depuis plus de dix ans. Personne n'en voulait. Je l'ai acheté, pour un morceau de pain, comme dit ce bêlant Alfred de Musset. Après s'être fait tirer l'oreille, mon père a fini par me donner l'argent nécessaire à l'exécution de cette folie. Peut-être a-t-il pensé que j'allais abandonner la peinture pour l'agriculture, et élever du bétail sur mes pentes ? Enfin, je suis propriétaire ! Et cela me semble tout drôle. Je pense que tu ne me reconnaîtras pas. Je suis sûr que, pour honorer ma nouvelle qualité sociale, j'ai déjà pris du ventre, comme il convient, et acquis cette supériorité spéciale à « l'homme qui possède ».
 DesolationRowEmpereur
DesolationRowEmpereur
Alexandrie, dans le Quatuor de Lawrence Durrell.
 User5899Demi-dieu
User5899Demi-dieu
Merci pour cette idée de topic. Une évocation que je lis toujours en frissonnant. Qui dira ensuite que Giono est un écrivain mineur ? Cette ponctuation !
Un roi sans divertissement
Décembre. L'hiver qui avait commencé tôt et depuis, dare-dare, sans démarrer. Chaque jour, la bise ; les nuages s'entassent dans le fer à cheval entre l'Archat, le Jocond, la Plainie, le mont de Pâtres et l'Avers. Aux nuages d'octobre déjà noirs se sont ajoutés les nuages de novembre encore plus noirs, puis ceux de décembre par dessus, très noirs et très lourds. Tout se tasse sur nous, sans bouger. La lumière a été verte, puis boyau de lièvre, puis noire avec cette particularité que, malgré ce noir, elle a des ombres d'un pourpre profond. Il y a huit jours on voyait encore le Habert du Jocond, la lisière des bois de sapins, la clairière des gentianes, un petit bout des près qui pendent d'en haut. Puis les nuages ont caché tous ça. Bon. Alors, on voyait encore Préfleuri et les troncs d'arbres qu'on a jetés de la coupe, puis, les nuages sont encore descendus et ont caché Préfleuri et les troncs d'arbres. Bon. Les nuages se sont arrêtés le long de la route qui monte au col. On voyait les érables et la Patache de midi et quart pour Saint-Maurice. Il n'y avait pas encore de neige, on se dépêchait à passer le col dans les deux sens. On voyait encore très bien l'auberge (cette bâtisse que maintenant on appelle Texaco parce qu'on fait de la réclame pour de l'huile d'auto sur ses murs), on voyait l'auberge et tout un trafic de chevaux de renforts pour des fardiers qui se dépêchaient de profiter du passage libre. On a vu le cabriolet du voyageur de la maison Colomb et Bernard, marchands de boulons à Grenoble. Il descendait du col. Quand celui-là rentrait, c'est que le col n'allait pas tarder à être bouché. Puis, les nuages ont couvert la route, Texaco et tout ; ont bavé en dessous dans les prés de Bernard, les haies vives ; et, ce matin, on voit, bien entendu, encore les vingt à vingt-cinq maisons du village avec leur épaisse barre d'ombre pourpre sous l'auvent, mais on ne voit plus la flèche du clocher, elle est coupé ras par le nuage, juste au-dessus des Sud, Nord, Est, Ouest.
D'ailleurs, tout de suite après il se met à tomber de la neige. A midi, tout est couvert, tout est effacé, il n'y a plus de monde, plus de bruits, plus rien. Des fumées lourdes coulent le long des toits, et emmantellent les maisons ; l'ombre des fenêtres, le papillonnement de la neige qui tombe l'éclaircit et la rend d'un rose sang frais dans lequel on voit battre le métronome d'une main qui essuie le givre de la vitre, puis apparaît dans le carreau un visage émacié et cruel qui regarde.
Tous ces visages, qu'ils soient d'hommes, de femmes, même d'enfants, ont des barbes postiches faites de l'obscurité des pièces desquelles ils émergent, des barbes de raphia noir qui mangent leurs bouches. Ils ont tous l'air de prêtres d'une sorte de serpent à plumes, même le curé catholique, malgré l'ora pro nobis gravé sur le linteau de la fenêtre.
Une heure, deux heures, trois heures, la neige continue à tomber. Quatre heures ; la nuit ; on allume les âtres ; il neige. Cinq heures. Six, sept ; on allume les lampes ; il neige. Dehors, il n'y a plus ni terre ni ciel, ni village, ni montagne ; il n'y a plus que les amas croulants de cette épaisse poussière glacée d'un monde qui a dû éclater. La pièce même où l'âtre s'éteint n'est plus habitable. Il n'y a plus d'habitable, c'est-à-dire il n'y a plus d'endroits où l'on puisse imaginer un monde aux couleurs du paon, que le lit. Et encore, bien couverts et bien serrés, à deux, ou à trois, quatre, des fois cinq. On n'imagine pas que ça puisse être encore si vaste, les corps.
Un roi sans divertissement
Décembre. L'hiver qui avait commencé tôt et depuis, dare-dare, sans démarrer. Chaque jour, la bise ; les nuages s'entassent dans le fer à cheval entre l'Archat, le Jocond, la Plainie, le mont de Pâtres et l'Avers. Aux nuages d'octobre déjà noirs se sont ajoutés les nuages de novembre encore plus noirs, puis ceux de décembre par dessus, très noirs et très lourds. Tout se tasse sur nous, sans bouger. La lumière a été verte, puis boyau de lièvre, puis noire avec cette particularité que, malgré ce noir, elle a des ombres d'un pourpre profond. Il y a huit jours on voyait encore le Habert du Jocond, la lisière des bois de sapins, la clairière des gentianes, un petit bout des près qui pendent d'en haut. Puis les nuages ont caché tous ça. Bon. Alors, on voyait encore Préfleuri et les troncs d'arbres qu'on a jetés de la coupe, puis, les nuages sont encore descendus et ont caché Préfleuri et les troncs d'arbres. Bon. Les nuages se sont arrêtés le long de la route qui monte au col. On voyait les érables et la Patache de midi et quart pour Saint-Maurice. Il n'y avait pas encore de neige, on se dépêchait à passer le col dans les deux sens. On voyait encore très bien l'auberge (cette bâtisse que maintenant on appelle Texaco parce qu'on fait de la réclame pour de l'huile d'auto sur ses murs), on voyait l'auberge et tout un trafic de chevaux de renforts pour des fardiers qui se dépêchaient de profiter du passage libre. On a vu le cabriolet du voyageur de la maison Colomb et Bernard, marchands de boulons à Grenoble. Il descendait du col. Quand celui-là rentrait, c'est que le col n'allait pas tarder à être bouché. Puis, les nuages ont couvert la route, Texaco et tout ; ont bavé en dessous dans les prés de Bernard, les haies vives ; et, ce matin, on voit, bien entendu, encore les vingt à vingt-cinq maisons du village avec leur épaisse barre d'ombre pourpre sous l'auvent, mais on ne voit plus la flèche du clocher, elle est coupé ras par le nuage, juste au-dessus des Sud, Nord, Est, Ouest.
D'ailleurs, tout de suite après il se met à tomber de la neige. A midi, tout est couvert, tout est effacé, il n'y a plus de monde, plus de bruits, plus rien. Des fumées lourdes coulent le long des toits, et emmantellent les maisons ; l'ombre des fenêtres, le papillonnement de la neige qui tombe l'éclaircit et la rend d'un rose sang frais dans lequel on voit battre le métronome d'une main qui essuie le givre de la vitre, puis apparaît dans le carreau un visage émacié et cruel qui regarde.
Tous ces visages, qu'ils soient d'hommes, de femmes, même d'enfants, ont des barbes postiches faites de l'obscurité des pièces desquelles ils émergent, des barbes de raphia noir qui mangent leurs bouches. Ils ont tous l'air de prêtres d'une sorte de serpent à plumes, même le curé catholique, malgré l'ora pro nobis gravé sur le linteau de la fenêtre.
Une heure, deux heures, trois heures, la neige continue à tomber. Quatre heures ; la nuit ; on allume les âtres ; il neige. Cinq heures. Six, sept ; on allume les lampes ; il neige. Dehors, il n'y a plus ni terre ni ciel, ni village, ni montagne ; il n'y a plus que les amas croulants de cette épaisse poussière glacée d'un monde qui a dû éclater. La pièce même où l'âtre s'éteint n'est plus habitable. Il n'y a plus d'habitable, c'est-à-dire il n'y a plus d'endroits où l'on puisse imaginer un monde aux couleurs du paon, que le lit. Et encore, bien couverts et bien serrés, à deux, ou à trois, quatre, des fois cinq. On n'imagine pas que ça puisse être encore si vaste, les corps.
 WabiSabiHabitué du forum
WabiSabiHabitué du forum
Cripure a écrit:Merci pour cette idée de topic. Une évocation que je lis toujours en frissonnant. Qui dira ensuite que Giono est un écrivain mineur ? Cette ponctuation !
Un roi sans divertissement
Décembre. L'hiver qui avait commencé tôt et depuis, dare-dare, sans démarrer. Chaque jour, la bise ; les nuages s'entassent dans le fer à cheval entre l'Archat, le Jocond, la Plainie, le mont de Pâtres et l'Avers. Aux nuages d'octobre déjà noirs se sont ajoutés les nuages de novembre encore plus noirs, puis ceux de décembre par dessus, très noirs et très lourds. Tout se tasse sur nous, sans bouger. La lumière a été verte, puis boyau de lièvre, puis noire avec cette particularité que, malgré ce noir, elle a des ombres d'un pourpre profond. Il y a huit jours on voyait encore le Habert du Jocond, la lisière des bois de sapins, la clairière des gentianes, un petit bout des près qui pendent d'en haut. Puis les nuages ont caché tous ça. Bon. Alors, on voyait encore Préfleuri et les troncs d'arbres qu'on a jetés de la coupe, puis, les nuages sont encore descendus et ont caché Préfleuri et les troncs d'arbres. Bon. Les nuages se sont arrêtés le long de la route qui monte au col. On voyait les érables et la Patache de midi et quart pour Saint-Maurice. Il n'y avait pas encore de neige, on se dépêchait à passer le col dans les deux sens. On voyait encore très bien l'auberge (cette bâtisse que maintenant on appelle Texaco parce qu'on fait de la réclame pour de l'huile d'auto sur ses murs), on voyait l'auberge et tout un trafic de chevaux de renforts pour des fardiers qui se dépêchaient de profiter du passage libre. On a vu le cabriolet du voyageur de la maison Colomb et Bernard, marchands de boulons à Grenoble. Il descendait du col. Quand celui-là rentrait, c'est que le col n'allait pas tarder à être bouché. Puis, les nuages ont couvert la route, Texaco et tout ; ont bavé en dessous dans les prés de Bernard, les haies vives ; et, ce matin, on voit, bien entendu, encore les vingt à vingt-cinq maisons du village avec leur épaisse barre d'ombre pourpre sous l'auvent, mais on ne voit plus la flèche du clocher, elle est coupé ras par le nuage, juste au-dessus des Sud, Nord, Est, Ouest.
D'ailleurs, tout de suite après il se met à tomber de la neige. A midi, tout est couvert, tout est effacé, il n'y a plus de monde, plus de bruits, plus rien. Des fumées lourdes coulent le long des toits, et emmantellent les maisons ; l'ombre des fenêtres, le papillonnement de la neige qui tombe l'éclaircit et la rend d'un rose sang frais dans lequel on voit battre le métronome d'une main qui essuie le givre de la vitre, puis apparaît dans le carreau un visage émacié et cruel qui regarde.
Tous ces visages, qu'ils soient d'hommes, de femmes, même d'enfants, ont des barbes postiches faites de l'obscurité des pièces desquelles ils émergent, des barbes de raphia noir qui mangent leurs bouches. Ils ont tous l'air de prêtres d'une sorte de serpent à plumes, même le curé catholique, malgré l'ora pro nobis gravé sur le linteau de la fenêtre.
Une heure, deux heures, trois heures, la neige continue à tomber. Quatre heures ; la nuit ; on allume les âtres ; il neige. Cinq heures. Six, sept ; on allume les lampes ; il neige. Dehors, il n'y a plus ni terre ni ciel, ni village, ni montagne ; il n'y a plus que les amas croulants de cette épaisse poussière glacée d'un monde qui a dû éclater. La pièce même où l'âtre s'éteint n'est plus habitable. Il n'y a plus d'habitable, c'est-à-dire il n'y a plus d'endroits où l'on puisse imaginer un monde aux couleurs du paon, que le lit. Et encore, bien couverts et bien serrés, à deux, ou à trois, quatre, des fois cinq. On n'imagine pas que ça puisse être encore si vaste, les corps.



J'ai un faible pour deux autres descriptions grandioses d'Un roi : celle de la vallée où s'est réfugié le descendant des V., celui qui lit Sylvie de Nerval devant sa maison qui cherche à se cacher et celle de l'arrivée des premiers signes de l'automne, avec le signal lancé par le premier hêtre, et la longue métaphore de tous ces arbres qui se colorent comme autant prêtres d'un culte païen vêtus de leurs parures cérémoniales... Mon dieu quel roman.
_________________
"De duobus malis, minus est semper eligendum."
"Plus je travaille moins, moins je glande plus. C'est shadokien." Lefteris
T2 ('17-'18) : TZR 2 collèges REP/REP+, 5e/4e/3e
T1 ('16-'17) : TZR AFA Collège, 2 5e + 2 4e
Stage ('15-'16) : Lycée GT, 1 2de + 1 1re S
 RogerMartinBon génie
RogerMartinBon génie
Desolation Row:  mais il va falloir citer les quatre romans in extenso, voilà qui va alourdir la page!
mais il va falloir citer les quatre romans in extenso, voilà qui va alourdir la page! 
Pour moi, dans l'ordre chronologique de découverte:
- le château de Sigognac dans le Capitaine Fracasse, l'un de mes premiers et meilleurs souvenirs de lecture...
- l'avenue de l'Observatoire et ses tilleuls dans les Thibault
- Troie ville fantome une fois Criseyde allée, dans le Troilus de Chaucer, au livre V
 mais il va falloir citer les quatre romans in extenso, voilà qui va alourdir la page!
mais il va falloir citer les quatre romans in extenso, voilà qui va alourdir la page! Pour moi, dans l'ordre chronologique de découverte:
- le château de Sigognac dans le Capitaine Fracasse, l'un de mes premiers et meilleurs souvenirs de lecture...
- Spoiler:
- Sur le revers d'une de ces collines décharnées qui bossuent les Landes, entre Dax et Mont−de−Marsan, s'élevait, sous le règne de Louis XIII, une de ces gentilhommières si communes en Gascogne, et que les villageois décorent du nom de château.
Deux tours rondes, coiffées de toits en éteignoir, flanquaient les angles d'un bâtiment, sur la façade duquel deux rainures profondément entaillées trahissaient l'existence primitive d'un pont−levis réduit à l'état de sinécure par le nivelage du fossé, et donnaient au manoir un aspect assez féodal, avec leurs échauguettes en poivrière et leurs girouettes à queue d'aronde. Une nappe de lierre enveloppant à demi l'une des tours tranchait heureusement par son vert sombre sur le ton gris de la pierre déjà vieille à cette époque.
Le voyageur qui eût aperçu de loin le castel dessinant ses faîtages pointus sur le ciel, au−dessus des genêts et des bruyères l'eût jugé une demeure convenable pour un hobereau de province ; mais, en approchant, son avis se fût modifié. Le chemin qui menait de la route à l'habitation s'était réduit, par l'envahissement de la mousse et des végétations parasites, à un étroit sentier blanc semblable à un galon terni sur un manteau râpé. Deux ornières remplies d'eau de pluie et habitées par des grenouilles témoignaient qu'anciennement des voitures avaient passé par là ; mais la sécurité de ces batraciens montrait une longue possession et la certitude de n'être pas dérangés. − Sur la bande frayée à travers les mauvaises herbes, et détrempée par une averse récente, on ne voyait aucune empreinte de pas humain, et les brindilles de broussailles, chargées de gouttelettes brillantes, ne paraissaient pas avoir été écartées depuis longtemps.
De larges plaques de lèpre jaune marbraient les tuiles brunies et désordonnées des toits, dont les chevrons pourris avaient cédé par place ; la rouille empêchait de tourner les girouettes, qui indiquaient toutes un vent différent ; les lucarnes étaient bouchées par des volets de bois déjeté et fendu. Des pierrailles remplissaient les barbacanes des tours ; sur les douze fenêtres de la façade, il y en avait huit barrées par des planches ; les deux autres montraient des vitres bouillonnées, tremblant, à la moindre pression de la bise, dans leur réseau de plomb. Entre ces fenêtres, le crépi, tombé par écailles comme les squames d'une peau malade, mettait à nu des briques disjointes, des moellons effrités aux pernicieuses influences de la lune ; la porte, encadrée d'un linteau de pierre, dont les rugosités régulières indiquaient une ancienne ornementation émoussée par le temps et l'incurie, était surmontée d'un blason fruste que le plus habile héraut d'armes eût été impuissant à déchiffrer et dont les lambrequins se contournaient fantasquement, non sans de nombreuses solutions de continuité.
Les vantaux de la porte offraient encore, vers le haut, quelques restes de peinture sang de boeuf et semblaient rougir de leur état de délabrement ; des clous à tête de diamant contenaient leurs ais fendillés et formaient des symétries interrompues çà et là. Un seul battant s'ouvrait et suffisait à la circulation des hôtes évidemment peu nombreux du castel, et contre le jambage de la porte s'appuyait une roue démantelée et tombant en javelle, dernier débris d'un carrosse défunt sous le règne précédent. Des nids d'hirondelles oblitéraient le faîte des cheminées et les angles des fenêtres, et, sans un mince filet de fumée qui sortait d'un tuyau de briques et se tortillait en vrille comme dans ces dessins de maisons que les écoliers griffonnent sur la marge de leurs livres de classe, on aurait pu croire le logis inhabité : maigre devait être la cuisine qui se préparait à ce foyer, car un soudard avec sa pipe eût produit des flocons plus épais. C'était le seul signe de vie que donnât la maison, comme ces mourants dont l'existence ne se révèle que par la vapeur de leur souffle.
En poussant le vantail mobile de la porte, qui ne cédait pas sans protester et tournait avec une évidente mauvaise humeur sur ses gonds oxydés et criards, on se trouvait sous une espèce de voûte ogivale plus ancienne que le reste du logis, et divisée par quatre boudins de granit bleuâtre se rencontrant à leur point d'intersection à une pierre en saillie où se revoyaient, un peu moins dégradées, les armoiries sculptées à l'extérieur, trois cigognes d'or sur champ d'azur, ou quelque chose d'analogue, car l'ombre de la voûte ne permettait pas de les bien distinguer. Dans le mur étaient scellés des éteignoirs en tôle noircis par les torches, et des anneaux de fer où s'attachaient autrefois les chevaux des visiteurs, événement bien rare aujourd'hui, à en croire la poussière qui les souillait.
De ce porche, sous lequel s'ouvraient deux portes, l'une conduisant aux appartements du rez−de−chaussée, l'autre à une salle qui avait pu jadis servir de salle des gardes, on débouchait dans une cour triste, nue et froide, entourée de hautes murailles rayées de longs filaments noirs par les pluies d'hiver. Dans les angles de la cour, parmi les gravats tombés des corniches ébréchées, poussaient l'ortie, la folle avoine et la ciguë, et les pavés étaient encadrés d'herbe verte.
Au fond, une rampe côtoyée de garde−fous en pierre ornés de boules surmontées de pointes menait à un jardin situé en contre−bas de la cour. Les marches rompues et disjointes faisaient bascule sous le pied ou n'étaient retenues que par les filaments des mousses et des plantes pariétaires ; sur l'appui de la terrasse avaient crû des joubarbes, des ravenelles et des artichauts sauvages.
Quant au jardin lui−même, il retournait doucement à l'état de hallier ou de forêt vierge. A l'exception d'un carré où se pommelaient quelques choux aux feuilles veinées et vert−de−grisées, et qu'étoilaient des soleils d'or au coeur noir, dont la présence témoignait d'une sorte de culture, la nature reprenait ses droits sur cet espace abandonné et en effaçait les traces du travail de l'homme qu'elle semble aimer à faire disparaître.
Les arbres non taillés projetaient en tous sens des branches gourmandes. Les buis, destinés à marquer le dessin des bordures et des allées, étaient devenus des arbustes, ne subissant plus le ciseau depuis longues années. Des graines apportées par le vent avaient germé au hasard et se développaient avec cette robustesse vivace, particulière aux mauvaises herbes, à la place qu'avaient occupée les jolies fleurs et les plantes rares. Les ronces, aux ergots épineux, se croisaient d'un bord à l'autre des sentiers et vous accrochaient au passage pour vous empêcher d'aller plus loin et vous dérober ce mystère de tristesse et de désolation. La solitude n'aime pas être surprise en déshabillé et sème autour d'elle toutes sortes d'obstacles.
Pourtant, si l'on eût persisté, sans redouter les égratignures des broussailles et les soufflets des branches, à suivre jusqu'au bout l'antique allée devenue plus obstruée et plus touffue qu'une sente dans les bois, on serait arrivé à une espèce de niche de rocaille figurant un antre rustique. Aux plantes semées jadis entre l'interstice des roches, telles qu'iris, glaïeuls, lierre noir, il s'en était ajouté d'autres, persicaires, scolopendres, lambruches sauvages qui pendaient comme des barbes, et voilaient à demi une statue de marbre représentant une divinité mythologique, Flore ou Pomone, laquelle avait dû être fort galante en son temps et faire honneur à l'ouvrier, mais qui était camarade comme la Mort, ayant le nez cassé. La pauvre déesse portait en sa corbeille, au lieu de fleurs, des champignons moisis et d'aspect vénéneux ; elle−même semblait avoir été empoisonnée, car des taches de mousse brune tigraient son corps jadis si blanc. A ses pieds croupissait, sous une couche verte de lentilles d'eau dans une conque de pierre, une flaque brune, résidu des pluies ; car le mufle de lion, qu'on pouvait encore discerner au besoin, ne vomissait plus d'eau, n'en recevant pas des conduits bouchés ou détruits.
Ce cabinet grotesque, comme on disait alors, témoignait, tout ruiné qu'il était, d'une certaine aisance disparue et du goût pour les arts des anciens possesseurs du castel. Convenablement décrassée et restaurée, la statue eût laissé voir le style florentin de la Renaissance à la manière des sculpteurs italiens venus en France à la suite de maître Roux ou du Primatice, époque probable des splendeurs de la famille maintenant déchue.
La grotte s'appuyait à une muraille verdie et salpêtrée, où s'entre-croisaient encore des restes de treillages rompus, et destinés sans doute à masquer les parois du mur, lors de sa construction, sous un rideau de plantes grimpantes et feuillues. Cette muraille, à peine visible à travers les frondaisons désordonnées des arbres démesurément grandis, fermait le jardin de ce côté. Au delà s'étendait la lande avec son horizon triste et bas, pommelé de bruyères
- l'avenue de l'Observatoire et ses tilleuls dans les Thibault
- Troie ville fantome une fois Criseyde allée, dans le Troilus de Chaucer, au livre V
- Spoiler:
 User5899Demi-dieu
User5899Demi-dieu
Parfaitement d'accord. Et Frédéric au réveil, juste avant la poursuite ? Et la battue aux loups ?WabiSabi a écrit: J'ai un faible pour deux autres descriptions grandioses d'Un roi : celle de la vallée où s'est réfugié le descendant des V., celui qui lit Sylvie de Nerval devant sa maison qui cherche à se cacher et celle de l'arrivée des premiers signes de l'automne, avec le signal lancé par le premier hêtre, et la longue métaphore de tous ces arbres qui se colorent comme autant prêtres d'un culte païen vêtus de leurs parures cérémoniales... Mon dieu quel roman.
Sinon, je rêve aussi sur L'Île mystérieuse, particulièrement ce long passage.
La façade de Granite–House allait donc être éclairée au moyen de cinq fenêtres et d’une porte, desservant ce qui constituait «l’appartement» proprement dit, et au moyen d’une large baie et d’œils-de-bœuf qui permettraient à la lumière d’entrer à profusion dans cette merveilleuse nef qui devait servir de grande salle. Cette façade, située à une hauteur de quatre-vingts pieds au-dessus du sol, était exposée à l’est, et le soleil levant la saluait de ses premiers rayons. Elle se développait sur cette portion de la courtine comprise entre le saillant faisant angle sur l’embouchure de la Mercy, et une ligne perpendiculairement tracée au-dessus de l’entassement de roches qui formaient les Cheminées.
Ainsi les mauvais vents, c’est-à-dire ceux du nord-est, ne la frappaient que d’écharpe, car elle était protégée par l’orientation même du saillant.
D’ailleurs, et en attendant que les châssis des fenêtres fussent faits, l’ingénieur avait l’intention de clore les ouvertures avec des volets épais, qui ne laisseraient passer ni le vent, ni la pluie, et qu’il pourrait dissimuler au besoin.
Le premier travail consista donc à évider ces ouvertures. La manœuvre du pic sur cette roche dure eût été trop lente, et on sait que Cyrus Smith était l’homme des grands moyens. Il avait encore une certaine quantité de nitro-glycérine à sa disposition, et il l’employa utilement. L’effet de la substance explosive fut convenablement localisé, et, sous son effort, le granit se défonça aux places mêmes choisies par l’ingénieur. Puis, le pic et la pioche achevèrent le dessin ogival des cinq fenêtres, de la vaste baie, des œils-de-bœuf et de la porte, ils en dégauchirent les encadrements, dont les profils furent assez capricieusement arrêtés, et, quelques jours après le commencement des travaux, Granite–House était largement éclairée par cette lumière du levant, qui pénétrait jusque dans ses plus secrètes profondeurs.
Suivant le plan arrêté par Cyrus Smith, l’appartement devait être divisé en cinq compartiments prenant vue sur la mer : à droite, une entrée desservie par une porte à laquelle aboutirait l’échelle, puis une première chambre-cuisine, large de trente pieds, une salle à manger, mesurant quarante pieds, une chambre-dortoir, d’égale largeur, et enfin une «chambre d’amis», réclamée par Pencroff, et qui confinait à la grande salle.
Ces chambres, ou plutôt cette suite de chambres, qui formaient l’appartement de Granite–House, ne devaient pas occuper toute la profondeur de la cavité. Elles devaient être desservies par un corridor ménagé entre elles et un long magasin, dans lequel les ustensiles, les provisions, les réserves trouveraient largement place. Tous les produits recueillis dans l’île, ceux de la flore comme ceux de la faune, seraient là dans des conditions excellentes de conservation, et complètement à l’abri de l’humidité. L’espace ne manquait pas, et chaque objet pourrait être méthodiquement disposé. En outre, les colons avaient encore à leur disposition la petite grotte située au-dessus de la grande caverne, et qui serait comme le grenier de la nouvelle demeure.
Ce plan arrêté, il ne restait plus qu’à le mettre à exécution. Les mineurs redevinrent donc briquetiers; puis, les briques furent apportées et déposées au pied de Granite–House.
Jusqu’alors Cyrus Smith et ses compagnons n’avaient eu accès dans la caverne que par l’ancien déversoir. Ce mode de communication les obligeait d’abord à monter sur le plateau de Grande-vue en faisant un détour par la berge de la rivière, à descendre deux cents pieds par le couloir, puis à remonter d’autant quand ils voulaient revenir au plateau. De là, perte de temps et fatigues considérables. Cyrus Smith résolut donc de procéder sans retard à la fabrication d’une solide échelle de corde, qui, une fois relevée, rendrait l’entrée de Granite–House absolument inaccessible.
Cette échelle fut confectionnée avec un soin extrême, et ses montants, formés des fibres du «curry-jonc» tressées au moyen d’un moulinet, avaient la solidité d’un gros câble. Quant aux échelons, ce fut une sorte de cèdre rouge, aux branches légères et résistantes, qui les fournit, et l’appareil fut travaillé de main de maître par Pencroff.
D’autres cordes furent également fabriquées avec des fibres végétales, et une sorte de moufle grossière fut installée à la porte. De cette façon, les briques purent être facilement enlevées jusqu’au niveau de Granite–House. Le transport des matériaux se trouvait ainsi très simplifié, et l’aménagement intérieur proprement dit commença aussitôt. La chaux ne manquait pas, et quelques milliers de briques étaient là, prêtes à être utilisées. On dressa aisément la charpente des cloisons, très rudimentaire d’ailleurs, et, en un temps très court, l’appartement fut divisé en chambres et en magasin, suivant le plan convenu.
[...]
Le 31 mai, les cloisons étaient achevées. Il ne restait plus qu’à meubler les chambres, ce qui serait l’ouvrage des longs jours d’hiver. Une cheminée fut établie dans la première chambre, qui servait de cuisine. Le tuyau destiné à conduire la fumée au dehors donna quelque travail aux fumistes improvisés. Il parut plus simple à Cyrus Smith de le fabriquer en terre de brique; comme il ne fallait pas songer à lui donner issue par le plateau supérieur, on perça un trou dans le granit au-dessus de la fenêtre de ladite cuisine, et c’est à ce trou que le tuyau, obliquement dirigé, aboutit comme celui d’un poêle en tôle. Peut-être, sans doute même, par les grands vents d’est qui battaient directement la façade, la cheminée fumerait, mais ces vents étaient rares, et, d’ailleurs, maître Nab, le cuisinier, n’y regardait pas de si près.
Quand ces aménagements intérieurs eurent été achevés, l’ingénieur s’occupa d’obstruer l’orifice de l’ancien déversoir qui aboutissait au lac, de manière à interdire tout accès par cette voie. Des quartiers de roches furent roulés à l’ouverture et cimentés fortement. Cyrus Smith ne réalisa pas encore le projet qu’il avait formé de noyer cet orifice sous les eaux du lac en les ramenant à leur premier niveau par un barrage. Il se contenta de dissimuler l’obstruction au moyen d’herbes, arbustes ou broussailles, qui furent plantés dans les interstices des roches, et que le printemps prochain devait développer avec exubérance.
Toutefois, il utilisa le déversoir de manière à amener jusqu’à la nouvelle demeure un filet des eaux douces du lac. Une petite saignée, faite au-dessous de leur niveau, produisit ce résultat, et cette dérivation d’une source pure et intarissable donna un rendement de vingt-cinq à trente gallons par jour. L’eau ne devait donc jamais manquer à Granite–House.
Enfin, tout fut terminé, et il était temps, car la mauvaise saison arrivait. D’épais volets permettaient de fermer les fenêtres de la façade, en attendant que l’ingénieur eût eu le temps de fabriquer du verre à vitre.
Gédéon Spilett avait très artistement disposé, dans les saillies du roc, autour des fenêtres, des plantes d’espèces variées, ainsi que de longues herbes flottantes, et, de cette façon, les ouvertures étaient encadrées d’une pittoresque verdure d’un effet charmant.
Les habitants de la solide, saine et sûre demeure, ne pouvaient donc être qu’enchantés de leur ouvrage.
Les fenêtres permettaient à leur regard de s’étendre sur un horizon sans limite, que les deux caps Mandibule fermaient au nord et le cap Griffe au sud.
Toute la baie de l’Union se développait magnifiquement devant eux. Oui, ces braves colons avaient lieu d’être satisfaits, et Pencroff ne marchandait pas les éloges à ce qu’il appelait humoristiquement «son appartement au cinquième au-dessus de l’entresol!»
 RogerMartinBon génie
RogerMartinBon génie

Quand j'étais gamine, je lisais avec passion toutes les descriptions du Robinson suisse, où la famille naufragée aménage une grotte, un arbre, etc. Maintenant, malheureusement, je trouve la traduction nulle et l'enrobage religieux insupportable. Wys est tombé de son piédestal...
 WabiSabiHabitué du forum
WabiSabiHabitué du forum
Cripure, oui tout le passage qui va du réveil de Frédéric jusqu'à la traque dans la neige est un chef-d'oeuvre de suspense littéraire!
J'ai plus de mal avec Jules Verne, auquel je reste toujours hermetique (trop "sec" pour moi).
Sinon, pour participer, j'aime beaucoup la description du bric-à-brac régnant dans le magasin d'antiquités où Raphaël va découvrir La peau de chagrin. Un bel exemple du talent foutraque de Balzac. ^^
J'ai plus de mal avec Jules Verne, auquel je reste toujours hermetique (trop "sec" pour moi).
Sinon, pour participer, j'aime beaucoup la description du bric-à-brac régnant dans le magasin d'antiquités où Raphaël va découvrir La peau de chagrin. Un bel exemple du talent foutraque de Balzac. ^^
_________________
"De duobus malis, minus est semper eligendum."
"Plus je travaille moins, moins je glande plus. C'est shadokien." Lefteris
T2 ('17-'18) : TZR 2 collèges REP/REP+, 5e/4e/3e
T1 ('16-'17) : TZR AFA Collège, 2 5e + 2 4e
Stage ('15-'16) : Lycée GT, 1 2de + 1 1re S
 Pierre-HenriHabitué du forum
Pierre-HenriHabitué du forum
La plus belle, pour moi, la description de l'église de Combray, dont le clocher "avait contemplé Saint Louis et semblait le voir encore". Je suis trop paresseux pour recopier le passage.
Sinon, j'adore les descriptions qui font ressortir la splendeur de paysages qu'on jugerait de prime abord ingrats et privés de poésie. Veuillez pardonner mon obsession pour ce parolier, mais je le trouve incroyablement mésestimé.
WINDY TOWN Il s'agit des faubourgs industriels de Middlesborough, d'où il vient. Rien de poétique au départ, et pourtant, une chanson fabuleuse sur les souvenirs et les amours d'adolescence :
Driving down from the highland line
We done some gigs on the Clyde and the Tyne
They flew us in from a Hamburg strip
The taste of Dusseldorf still on our lips
And on the bus there is a friend of mine
We go way back to the scene of the crime
We sit up front and share a cigarette
Trying to remember what we tried to forget
He says "do you remember ?"
He says "do you recall ?"
I say "yes I remember, I remember it all"
Everytime that cold wind blows
Everytime I hear this sound
Late night trains shunting down by the river
I remember windy town
We come so far and we move so fast
Making hay see it all go past
Round the world and round again
Up and down on that gravy train
But everytime that cold wind blows
Everytime I hear this sound
East coast crosswinds on the cold wet stones
I remember windy town... oh windy town
The freezing corners and the empty streets
The burning passion and the cold wet feet
Three tricky miles home every night
Dodging from the shadows undernearth those amber lights
No car for kissing
And nowhere to go
Except inside each other
And I loved you so
I held your face as you shivered in the rain
Girl I'll always love you and I'll love you again
Oh everytime, everytime
Everytime that cold wind blows
Everytime I hear this sound
Late night trains shunting down by the river
I remember old windy town
Everytime that cold wind blows
Everytime I hear this sound
East coast crosswinds on the cold wet stone
I remember I remember windy town
There it goes... oh windy town
Sinon, j'adore les descriptions qui font ressortir la splendeur de paysages qu'on jugerait de prime abord ingrats et privés de poésie. Veuillez pardonner mon obsession pour ce parolier, mais je le trouve incroyablement mésestimé.
WINDY TOWN Il s'agit des faubourgs industriels de Middlesborough, d'où il vient. Rien de poétique au départ, et pourtant, une chanson fabuleuse sur les souvenirs et les amours d'adolescence :
Driving down from the highland line
We done some gigs on the Clyde and the Tyne
They flew us in from a Hamburg strip
The taste of Dusseldorf still on our lips
And on the bus there is a friend of mine
We go way back to the scene of the crime
We sit up front and share a cigarette
Trying to remember what we tried to forget
He says "do you remember ?"
He says "do you recall ?"
I say "yes I remember, I remember it all"
Everytime that cold wind blows
Everytime I hear this sound
Late night trains shunting down by the river
I remember windy town
We come so far and we move so fast
Making hay see it all go past
Round the world and round again
Up and down on that gravy train
But everytime that cold wind blows
Everytime I hear this sound
East coast crosswinds on the cold wet stones
I remember windy town... oh windy town
The freezing corners and the empty streets
The burning passion and the cold wet feet
Three tricky miles home every night
Dodging from the shadows undernearth those amber lights
No car for kissing
And nowhere to go
Except inside each other
And I loved you so
I held your face as you shivered in the rain
Girl I'll always love you and I'll love you again
Oh everytime, everytime
Everytime that cold wind blows
Everytime I hear this sound
Late night trains shunting down by the river
I remember old windy town
Everytime that cold wind blows
Everytime I hear this sound
East coast crosswinds on the cold wet stone
I remember I remember windy town
There it goes... oh windy town
 Pierre-HenriHabitué du forum
Pierre-HenriHabitué du forum
Encore plus sublime, peut-être la plus belle chanson jamais écrite, toute en ellipses, totalement intraduisible, qui transforme une bête portion d'autoroute en voyage spirituel :
HEAVEN
I see a turning wheel
On a dusty track
Caught in the void and empty space
In between there and back
And the paradise of going somewhere
That's still so far away
Happy, boy you bet I am
Holding on to this smile
For just as long as I can
Heaven
It's all bright in front
It's all dark behind
Living for the "now" that's in between
The bridges and the signs
And getting there is still
A long long way to go
While the others dream and wish
This is everything I officially need to know
Happy, boy you bet I am
Holding on to this smile
For just as long as I can
Heaven
HEAVEN
I see a turning wheel
On a dusty track
Caught in the void and empty space
In between there and back
And the paradise of going somewhere
That's still so far away
Happy, boy you bet I am
Holding on to this smile
For just as long as I can
Heaven
It's all bright in front
It's all dark behind
Living for the "now" that's in between
The bridges and the signs
And getting there is still
A long long way to go
While the others dream and wish
This is everything I officially need to know
Happy, boy you bet I am
Holding on to this smile
For just as long as I can
Heaven
 MamaVénérable
MamaVénérable
Puisqu'on est dans les vers, ce poème de Verhaeren me plonge toujours dans des affres de compassion pour le monde moderne, tout en me donnant des frissons musicaux...
- Spoiler:
- Les usines
Se regardant avec les yeux cassés de leurs fenêtres
Et se mirant dans l'eau de poix et de salpêtre
D'un canal droit, marquant sa barre à l'infini, .
Face à face, le long des quais d'ombre et de nuit,
Par à travers les faubourgs lourds
Et la misère en pleurs de ces faubourgs,
Ronflent terriblement usine et fabriques.
Rectangles de granit et monuments de briques,
Et longs murs noirs durant des lieues,
Immensément, par les banlieues ;
Et sur les toits, dans le brouillard, aiguillonnées
De fers et de paratonnerres,
Les cheminées.
Se regardant de leurs yeux noirs et symétriques,
Par la banlieue, à l'infmi.
Ronflent le jour, la nuit,
Les usines et les fabriques.
Oh les quartiers rouillés de pluie et leurs grand-rues !
Et les femmes et leurs guenilles apparues,
Et les squares, où s'ouvre, en des caries
De plâtras blanc et de scories,
Une flore pâle et pourrie.
Aux carrefours, porte ouverte, les bars :
Etains, cuivres, miroirs hagards,
Dressoirs d'ébène et flacons fols
D'où luit l'alcool
Et sa lueur vers les trottoirs.
Et des pintes qui tout à coup rayonnent,
Sur le comptoir, en pyramides de couronnes ;
Et des gens soûls, debout,
Dont les larges langues lapent, sans phrases,
Les ales d'or et le whisky, couleur topaze.
 Docteur OXGrand sage
Docteur OXGrand sage
"Au fin fond du désert d'Arabie gît la Cité sans Nom, délabrée et défigurée, ses remparts peu élevés enfouis sous le sable accumulé par les siècles. Telle était-elle sans doute, dès avant la fondation de Memphis, alors que les briques de Babylone n'étaient pas encore cuites. Il n'y a pas de légende assez ancienne pour révéler son nom, ou évoquer le temps de sa gloire, mais on en parle autour des feux de camp et sous la tente des cheikhs et les aïeules parfois y font allusion ; aussi toutes les tribus s'en écartent-elles, sans trop savoir pourquoi. C'est d'elle qu'avait rêvé une nuit Abdul Alhazred, le poète fou, avant de composer ces vers énigmatiques :
N'est pas mort ce qui à jamais dort
Et au long des siècles peut mourir même la mort
J'aurais dû savoir que les Arabes avaient de bonnes raisons pour se détourner de la Cité sans Nom, la cité connue par d'étranges récits, mais que nul mortel n'avait vue. Pourtant je les bravai, et m'en allai à dos de chameau dans le désert vierge. Moi seul y suis allé et c'est pourquoi aucun visage que le mien ne porte les stigmates d'une peur aussi hideuse ; c'est pourquoi je suis seul à frémir la nuit, quand le vent ébranle les fenêtres. Lorsque j'arrivai à la Cité sans Nom, au clair de lune, elle semblait me regarder, dans le calme de son sommeil éternel, froide dans la chaleur du désert."
Howard Philips Lovecraft
La Cité sans Nom
 e-WandererGrand sage
e-WandererGrand sage
Barbey d'Aurevilly, l'incipit de L'Encorcelée :
La lande de Lessay est une des plus considérables de cette portion de la Normandie qu’on appelle la presqu’île du Cotentin. Pays de culture, de vallées fertiles, d’herbages verdoyants, de rivières poissonneuses, le Cotentin, cette Tempé de la France, cette terre grasse et remuée, a pourtant, comme la Bretagne, sa voisine, la pauvresse aux genêts, de ces parties stériles et nues où l’homme passe et où rien ne vient, sinon une herbe rare et quelques bruyères bientôt desséchées. Ces lacunes de culture, ces places vides de végétation, ces terres chauves pour ainsi dire, forment d’ordinaire un frappant contraste avec les terrains qui les environnent. Elles sont à ces pays cultivés des oasis arides, comme il y a dans les sables du désert des oasis de verdure. Elles jettent dans ces paysages frais, riants et féconds, de soudaines interruptions de mélancolie, des airs soucieux, des aspects sévères. Elles les ombrent d’une estompe plus noire… Généralement ces landes ont un horizon assez borné. Le voyageur, en y entrant, les parcourt d’un regard et en aperçoit la limite. De partout, les haies des champs labourés les circonscrivent. Mais, si, par exception, on en trouve d’une vaste largeur de circuit, on ne saurait dire l’effet qu’elles produisent sur l’imagination de ceux qui les traversent, de quel charme bizarre et profond elles saisissent les yeux et le cœur. Qui ne sait le charme des landes ?… Il n’y a peut-être que les paysages maritimes, la mer et ses grèves, qui aient un caractère aussi expressif et qui vous émeuvent davantage. Elles sont comme les lambeaux, laissés sur le sol, d’une poésie primitive et sauvage que la main et la herse de l’homme ont déchirée. Haillons sacrés qui disparaîtront au premier jour sous le souffle de l’industrialisme moderne ; car notre époque, grossièrement matérialiste et utilitaire, a pour prétention de faire disparaître toute espèce de friche et de broussailles aussi bien du globe que de l’âme humaine. Asservie aux idées de rapport, la société, cette vieille ménagère qui n’a plus de jeune que ses besoins et qui radote de ses lumières, ne comprend pas plus les divines ignorances de l’esprit, cette poésie de l’âme qu’elle veut échanger contre de malheureuses connaissances toujours incomplètes, qu’elle n’admet la poésie des yeux, cachée et visible sous l’apparente inutilité des choses. Pour peu que cet effroyable mouvement de la pensée moderne continue, nous n’aurons plus, dans quelques années, un pauvre bout de lande où l’imagination puisse poser son pied pour rêver, comme le héron sur une de ses pattes. Alors, sous ce règne de l’épais génie des aises physiques qu’on prend pour de la Civilisation et du Progrès, il n’y aura ni ruines, ni mendiants, ni terres vagues, ni superstitions comme celles qui vont faire le sujet de cette histoire, si la sagesse de notre temps veut bien nous permettre de la raconter.
C’était cette double poésie de l’inculture du sol et de l’ignorance de ceux qui la hantaient qu’on retrouvait encore, il y a quelques années, dans la sauvage et fameuse lande de Lessay. Ceux qui y sont passés alors pourraient l’attester. Placé entre la Haie-du-Puits et Coutances, ce désert normand, où l’on ne rencontrait ni arbres, ni maisons, ni haies, ni traces d’homme ou de bêtes que celles du passant ou du troupeau du matin., dans la poussière, s’il faisait sec, ou dans l’argile détrempée du sentier, s’il avait plu, déployait une grandeur de solitude et de tristesse désolée qu’il n’était pas facile d’oublier. La lande, disait-on, avait sept lieues de tour. Ce qui est certain, c’est que, pour la traverser en droite ligne, il fallait à un homme à cheval et bien monté plus d’une couple d’heures. Dans l’opinion de tout le pays, c’était un passage redoutable. Quand de Saint-Sauveur-le-Vicomte, cette bourgade jolie comme un village d’Écosse et qui a vu Du Guesclin défendre son donjon contre les Anglais, ou du littoral de la presqu’île, on avait affaire à Coutances et que, pour arriver plus vite, on voulait prendre la traverse, car la route départementale et les voitures publiques n’étaient pas de ce côté, on s’associait plusieurs pour passer la terrible lande ; et c’était si bien en usage qu’on citait longtemps comme des téméraires, dans les paroisses, les hommes, en très petit nombre, il est vrai, qui avaient passé seuls à Lessay de nuit ou de jour.
On parlait vaguement d’assassinats qui s’y étaient commis à d’autres époques. Et vraiment un tel lieu prêtait à de telles traditions. Il aurait été difficile de choisir une place plus commode pour détrousser un voyageur ou pour dépêcher un ennemi, L’étendue, devant et autour de soi, était si considérable et si claire qu’on pouvait découvrir de très loin, pour les éviter ou les fuir, les personnes qui auraient pu venir au secours des gens attaqués par les bandits de ces parages, et, dans la nuit, un si vaste silence aurait dévoré tous les cris qu’on aurait poussés dans son sein.
 RogerMartinBon génie
RogerMartinBon génie
e-Wanderer a écrit:Barbey d'Aurevilly, l'incipit de L'Encorcelée :
La lande de Lessay est une des plus considérables de cette portion de la Normandie qu’on appelle la presqu’île du Cotentin. Pays de culture, de vallées fertiles, d’herbages verdoyants, de rivières poissonneuses, le Cotentin, cette Tempé de la France, cette terre grasse et remuée, a pourtant, comme la Bretagne, sa voisine, la pauvresse aux genêts, de ces parties stériles et nues où l’homme passe et où rien ne vient, sinon une herbe rare et quelques bruyères bientôt desséchées. Ces lacunes de culture, ces places vides de végétation, ces terres chauves pour ainsi dire, forment d’ordinaire un frappant contraste avec les terrains qui les environnent. Elles sont à ces pays cultivés des oasis arides, comme il y a dans les sables du désert des oasis de verdure. Elles jettent dans ces paysages frais, riants et féconds, de soudaines interruptions de mélancolie, des airs soucieux, des aspects sévères. Elles les ombrent d’une estompe plus noire… Généralement ces landes ont un horizon assez borné. Le voyageur, en y entrant, les parcourt d’un regard et en aperçoit la limite. De partout, les haies des champs labourés les circonscrivent. Mais, si, par exception, on en trouve d’une vaste largeur de circuit, on ne saurait dire l’effet qu’elles produisent sur l’imagination de ceux qui les traversent, de quel charme bizarre et profond elles saisissent les yeux et le cœur. Qui ne sait le charme des landes ?… Il n’y a peut-être que les paysages maritimes, la mer et ses grèves, qui aient un caractère aussi expressif et qui vous émeuvent davantage. Elles sont comme les lambeaux, laissés sur le sol, d’une poésie primitive et sauvage que la main et la herse de l’homme ont déchirée. Haillons sacrés qui disparaîtront au premier jour sous le souffle de l’industrialisme moderne ; car notre époque, grossièrement matérialiste et utilitaire, a pour prétention de faire disparaître toute espèce de friche et de broussailles aussi bien du globe que de l’âme humaine. Asservie aux idées de rapport, la société, cette vieille ménagère qui n’a plus de jeune que ses besoins et qui radote de ses lumières, ne comprend pas plus les divines ignorances de l’esprit, cette poésie de l’âme qu’elle veut échanger contre de malheureuses connaissances toujours incomplètes, qu’elle n’admet la poésie des yeux, cachée et visible sous l’apparente inutilité des choses. Pour peu que cet effroyable mouvement de la pensée moderne continue, nous n’aurons plus, dans quelques années, un pauvre bout de lande où l’imagination puisse poser son pied pour rêver, comme le héron sur une de ses pattes. Alors, sous ce règne de l’épais génie des aises physiques qu’on prend pour de la Civilisation et du Progrès, il n’y aura ni ruines, ni mendiants, ni terres vagues, ni superstitions comme celles qui vont faire le sujet de cette histoire, si la sagesse de notre temps veut bien nous permettre de la raconter.
C’était cette double poésie de l’inculture du sol et de l’ignorance de ceux qui la hantaient qu’on retrouvait encore, il y a quelques années, dans la sauvage et fameuse lande de Lessay. Ceux qui y sont passés alors pourraient l’attester. Placé entre la Haie-du-Puits et Coutances, ce désert normand, où l’on ne rencontrait ni arbres, ni maisons, ni haies, ni traces d’homme ou de bêtes que celles du passant ou du troupeau du matin., dans la poussière, s’il faisait sec, ou dans l’argile détrempée du sentier, s’il avait plu, déployait une grandeur de solitude et de tristesse désolée qu’il n’était pas facile d’oublier. La lande, disait-on, avait sept lieues de tour. Ce qui est certain, c’est que, pour la traverser en droite ligne, il fallait à un homme à cheval et bien monté plus d’une couple d’heures. Dans l’opinion de tout le pays, c’était un passage redoutable. Quand de Saint-Sauveur-le-Vicomte, cette bourgade jolie comme un village d’Écosse et qui a vu Du Guesclin défendre son donjon contre les Anglais, ou du littoral de la presqu’île, on avait affaire à Coutances et que, pour arriver plus vite, on voulait prendre la traverse, car la route départementale et les voitures publiques n’étaient pas de ce côté, on s’associait plusieurs pour passer la terrible lande ; et c’était si bien en usage qu’on citait longtemps comme des téméraires, dans les paroisses, les hommes, en très petit nombre, il est vrai, qui avaient passé seuls à Lessay de nuit ou de jour.
On parlait vaguement d’assassinats qui s’y étaient commis à d’autres époques. Et vraiment un tel lieu prêtait à de telles traditions. Il aurait été difficile de choisir une place plus commode pour détrousser un voyageur ou pour dépêcher un ennemi, L’étendue, devant et autour de soi, était si considérable et si claire qu’on pouvait découvrir de très loin, pour les éviter ou les fuir, les personnes qui auraient pu venir au secours des gens attaqués par les bandits de ces parages, et, dans la nuit, un si vaste silence aurait dévoré tous les cris qu’on aurait poussés dans son sein.
 Même si l'endroit est moins mystérieux aujourd'hui.
Même si l'endroit est moins mystérieux aujourd'hui. User5899Demi-dieu
User5899Demi-dieu
Super. Je l'ai retrouvé numérisé. J'avais la flemme de le retaper.
Du coup, je mets tout, c'est assez long. Ne trichez pas avec gougueule : qui c'est ?
Du coup, je mets tout, c'est assez long. Ne trichez pas avec gougueule : qui c'est ?
- Spoiler:
[…] Le vallon dormant de l’Èvre, petit affluent inconnu de la Loire qui débouche dans le fleuve à quinze cents mètres de Saint-Florent, enclôt dans le paysage de mes années lointaines un canton privilégié, plus secrètement, plus somptueusement coloré que les autres, une réserve fermée qui reste liée de naissance aux seules idées de promenade, de loisir et de fête agreste. Ce qui constituait d’abord pour moi, il me semble, sa singularité, c’était que l’Èvre, comme certains fleuves fabuleux de l’ancienne Afrique, n’avait ni source ni embouchure qu’on pût visiter. Du côté de la Loire, un barrage noyé, fait de moellons bruts culbutés en vrac, et qu’on pouvait traverser à sec en été vers L’Île aux Bergères, empêche de remonter la rivière à partir du fleuve ; un fouillis de frênes, de peupliers et de saules cernait le lacis des bras au-delà du barrage, et décourageait l’exploration vers l’aval. Vers l’amont, à cinq ou six kilomètres, un barrage de moulin, à Coulènes, interdit aux barques de remonter plus avant. Aller sur l’Èvre se trouvait ainsi lié à un cérémonial assez exigeant qu’il convenait de prévoir un jour ou deux à l’avance : le temps d’alerter dans un café du Marillais la tenancière et de retenir l’unique bachot centenaire – bancal, délabré, vermoulu, cloqué de gou-dron, et parfois dépourvu de gouvernail – qu’elle gardait cadenassé près du barrage et prêtait aux consommateurs de son établissement ; en guise de tolets, la tige des avirons dépareillés coulissait dans un nœud d’osier. La brûlure piquante et assoiffante de la limonade tiède reste par là inséparable dans mon souvenir des préparatifs de l’appareillage : je la retrouve intacte sur ma langue quand je relis le récit du pique-nique au bord du Cher dans Le Grand Meaulnes. Là comme au Marillais elle fait exploser encore contre mon palais je ne sais quel goût exotique et perdu de jeudi carillonné et de frairie modeste.
On s’embarquait – on s’embarque, je pense, toujours – au bas d’un escalier de planches qui dégringolait la haute berge glaiseuse ; les branches se croisaient au-dessus de l’étroit chenal d’eau noire ; on entrait de plain-pied dans une zone de silence plus subtil et comme alerté, ami de l’eau comme l’est la brume, et que rompait seulement l’égouttement plat et liquide des pales des avirons relevés. Presque aussitôt venait battre un instant le bordé l’écho à la fois caverneux et étoffé de la voûte du pont de pierre ; au-delà, la rivière s’élargissait entre des prairies basses bordées de rouches, roseaux coupants où s’embusquait parfois, palissadé jusqu’au menton, un pêcheur figé et soupçonneux comme une sentinelle ; là s’étalaient déjà partout en travers de la rivière les constellations vertes et flottantes des peuplements de châtaignes d’eau qu’on soulevait au retour et qu’on inspectait comme des filets pour y récolter les macres aux cornes aiguës : petits crânes végétaux épineux que la cuisson durcit et qui livrent, fendus, en guise de cervelle, une noisette au goût douceâtre de sucre et de vase, friable et grenue, et qui crisse entre les dents.
Rien n’est surprenant dans mon souvenir comme la variété miniaturiste des paysages que longe le cours sinueux de la rivière dans l’espace de ces quelques kilomètres : si lentement que glisse la barque dans l’eau stagnante, d’une couleur de café très dilué, ils semblent se succéder et se remplacer à la vitesse huilée des décors d’une scène à transformation, ou de ces toiles de diorama qui s’enroulaient et se déroulaient et défilaient devant le passager de Luna-Park assis dans sa barque vissée au plancher. Le plaisir exceptionnellement vif, et presque l’illusion de fausse reconnaissance, que m’a procuré dès les premières pages la lecture du Domaine d’Arnheim tient, je pense, à la sensation que la nouvelle de Poe communique simultanément de l’immobilité parfaite de l’eau et de la vitesse réglée de l’esquif qui semble moins saisi par un courant que plutôt tiré de l’avant par un aimant invisible. Plus tard, le cygne de Lohengrin, remontant, puis descendant sur la scène de l’Opéra les lacets de la rivière, m’a rendu une fois encore, fugitivement, cette sensation de félicité presque inquiétante qui tient – je ne l’ai compris qu’alors – à l’impression d’accélération faible et continue qui naît d’une telle navigation surnaturelle. Le sentiment de l’appel dans toute son urgence confiante loge pour nous dans ces esquifs ingénus – cygnes, caïques, auges de pierre – qui glissent dans les contes à la surface d’une eau immobile : à l’inverse de la suggestion toujours maléfique qui s’attache à l’apparition des objets volants non identifiés, le bonheur toujours, l’exaucement d’un vœu, tout au moins le secours surnaturel dans le péril, semble éperonner leur navigation silencieuse.
Je parle d’Edgar Poe, et voici qu’il ne va plus guère me quitter tout au long de cette excursion tant de fois recommencée – bien souvent en compagnie bruyante et joyeuse – et qui pourtant, non pas seulement dans mon souvenir, mais chaque fois et pendant même que je la recommençais, a gardé toujours quelque chose de l’allure du rêve, dans le défilé muet, incompréhensiblement majestueux, des deux rives qui viennent à moi et s’écartent comme les lèvres d’une Mer Rouge fendue, dans le sentiment à la fois de lenteur irréelle et de vitesse lisse que j’ai cru retrouver parfois dans les plus beaux, les plus vastes rêves d’opium de De Quincey. L’eau noire, l’eau lourde, l’eau mangeuse d’ombres qu’a décrite Gaston Bachelard, celle qui ceinture l’Île de la fée, celle qui attend au creux de ses douves de se refermer sur les décombres de la Maison Usher – si différente du flot insidieusement violent qui râpe et ratisse les grèves de la Loire, et renverse par les épaules comme un chien joueur le nageur qui cherche à reprendre pied – elle était là, elle fut pour moi tout de suite, avec son odeur terreuse de vase et de racines, son sommeil dissolvant : digérant, infusant lentement les feuilles mortes qui pleuvaient des arbres d’automne. Je n’y ai jamais plongé sans malaise : froide, inerte, sans éclaboussures et sans jaillissement, comme si on y avait plongé à travers une pellicule de lentilles d’eau.
Dès qu’on s’engageait sur l’Èvre, on pénétrait dans un canton retranché de la terre, dont la barque seule pouvait livrer la clef. Un sentier herbeux, le Chemin Vert, longe une des rives à partir du pont du Marillais sur quelques centaines de mètres et se termine en impasse à l’entrée d’un pré bossu ; au-delà, les clôtures de haies vives des prairies s’étendent jusqu’à la berge, que ne rejoint plus aucun chemin. Ainsi, quand nous passions en vue de la ferme de La Jolivière, haut perchée au-dessus de la rive sur son coteau, je m’étonnais toujours d’avoir pu la rejoindre deux ou trois fois par la voie de terre, à travers un lacis compliqué de chemins creux, itinéraire consacré de la longue file indienne que précédait chaque printemps la clochette des Rogations ; cette marche d’escalier du versant haut séparait deux parcours rituels d’espèce différente qui n’auraient jamais dû se recouper : voir le troupeau de la ferme dégringoler la coulée boueuse et venir boire tout uniment à la rivière me scandalisait, comme s’il avait violé une frontière mystique. Mais c’était bien là de tout le trajet le seul point où un témoin désenchantant de la terre cultivée fût un instant en vue ; la petite rivière semblait de bout en bout zigzaguer à travers un parc naturel ensauvagé, un recès protégé du loisir et du dimanche, où nulle part ne se montraient les stigmates du travail.
L’Èvre n’a guère qu’une vingtaine de mètres de large, parfois moins ; le lit est profond, criblé entre les souches pourries de trous et d’anfractuosités où s’abritent les brochets géants. Sans doute la pollution a-t-elle dépeuplé aujourd’hui la rivière comme toutes les autres, mais dans mon enfance, une partie de pêche sur l’Èvre signifiait qu’on courait sus au gros gibier : ces eaux couleur de réglisse passaient pour nourrir des bêtes centenaires, comme les étangs de Fontainebleau (et, pour mon imagination en tout cas, nul doute que l’Èvre profonde et noire était un peu comme cette mer ensorcelée du Manuscrit trouvé dans une bouteille, où tout ce qui y plongeait pouvait engraisser monstrueusement, même les navires). Quand on a passé le pont de pierre du Marillais, la rivière d’abord s’étale entre des prés mouillés où foisonnent au printemps les boutons d’or et les pâquerettes ; les bouquets de lances des roseaux de chaque côté pointent des berges, les avirons s’accrochent partout aux tiges noyées des nénuphars et des châtaignes d’eau qui ne découvrent qu’un étroit chenal d’eau libre. C’est encore ici le domaine des peupliers dont l’odeur des feuilles mortes sur les prés d’octobre, amère, astringente, qui rappelle parfois celle d’un vernis en train de sécher, est pour moi l’odeur même de l’automne dans la vallée. Ce sont presque, sur les deux rives, les gazons, les nymphées, les roselières décoratives et plumeuses d’un parc spacieux, mais les bruits de la vie courante ne se sont pas éteints d’un coup : le trot d’un cheval qui fait résonner au passage la voûte du pont de pierre se fait entendre encore de loin dans ma mémoire, le carillon languide qui tombe avec les heures du clocher du Marillais (on voit en se retournant sa silhouette quadrangulaire pointer par-dessus les roseaux et les touffes de carex) voyage longtemps jusqu’à vous sur les espaces d’eau morte. Le silence pourtant déjà se déchire malaisément ; il n’accueille plus que les échos espacés d’une vie distraite, que le rideau des peupliers commence à masquer. L’image du marais, qui s’est présentée un instant, juste après le pont, dans le caquètement des poules d’eau et le plongeon précipité des grenouilles cloquant l’eau pesante, laisse place pour un moment à celle des molles rivières de plaine qui vont entre les saules, dénouées comme une écharpe, infusées de soleil, traversées du vol des martins-pêcheurs et des libellules. Çà et là, une trouée ménagée entre les rouches aboutit sur la berge à deux ou trois gradins de planches pourries ; la gaule qui s’y incline en permanence comme une enseigne d’estaminet marque l’emplacement des affûts de pêche enviés qu’on se léguait ici autrefois de père en fils. Mais ces signes d’une présence humaine alertée sont trompeurs, comme les cabanes des alpages qui de loin font croire la montagne peuplée : quand on passe à l’aplomb de la trouée, la place est vide et la gaule fichée dans la glaise ; le propriétaire, qui se glisse sans bruit par intervalles de l’une à l’autre, en surveille parfois quatre ou cinq. Cette artillerie côtière parcimonieusement servie ne dépasse pas le bout du Chemin Vert, qui joue ici un peu avec ses écrans de roseaux le rôle d’un chemin de ronde, le long duquel les sentinelles se déplacent à couvert de créneau à créneau ; au-delà, la tension qu’on éprouve à longer un secteur miné et patrouillé cesse, et avec elle la consigne du silence. Déjà, plusieurs fois, la rivière s’est coudée ; le clocher du Marillais a disparu derrière les peupliers ; les coteaux bas qui bordent à distance les prés mouillés se resserrent et se rapprochent. Je suis allé bien souvent à pied au bout du Chemin Vert pique-niquer sur l’herbe. Ce qui commence plus loin, au-delà de la bosse d’une colline qui vient border la berge, c’est une autre contrée, non praticable au pied, non carrossable à la voiture, dont l’accès est réservé à certaines journées fastes : journées sans nuages de fête et de chaleur, que le soleil dès le matin consacre, et dont l’eau seule ouvre le chemin.
Presque tous les rituels d’initiation, si modeste qu’en soit l’objet, comportent le franchissement d’un couloir obscur, et il y a dans la promenade de l’Èvre un moment ingrat où l’attention se détourne, et où le regard se fait plus distrait. La rivière se resserre et se calibre ; les plantes d’eau et même les roseaux des rives un moment disparaissent. Les berges maintenant hautes et ébouleuses mettent à nu les racines des saules et des frênes têtards qui les retiennent mal ; les galeries des rats d’eau sapent de partout ces petites falaises instables. La berge s’élevant, on n’aperçoit plus, de la barque, que le plan d’eau étroit, les couleurs de la glaise qui le borde, les racines déchaussées, les rats qui cavalcadent sur les banquettes d’argile mouillée, et parfois la double ride fine, l’angle obtus du sillage d’une couleuvre qui traverse la rivière : pour un instant, un sentiment proche du malaise flotte sur ces berges cariées où s’anime un peu trop le trotte-menu de la boue. Mais, très vite, de nouveau la perspective change et s’aère : un objet flottant à la silhouette indéfinissable, qui tient à la fois du dais de la Fête-Dieu et d’une pagode de Lilliput, est en vue, amarré à demeure à la rive ; en approchant, le bordé très bas qui rase l’eau, le tendelet de zinc ajouré qui abrite la nacelle quadrangulaire, les traînées savonneuses qui s’allongent parfois à la surface de L’Èvre, font pressentir sa destination modestement utilitaire, mais cet ustensile miniaturiste est à un vrai bateau-lavoir à peu près ce qu’est une chaloupe à un vaisseau à trois ponts : il est triplace, et réservé aux seules lessives privées du château tout proche, dont on commence à apercevoir les girouettes au-delà d’une clairière de gazon anglais. Rien ne me jetait, enfant, dans un éblouissement aussi total, aussi éperdu, que le détournement à des fins privées d’un meuble dans mon esprit aussi électivement municipal : la possession par le châtelain d’un commissariat de police ou d’une caserne de sapeurs-pompiers ne m’eût pas stupéfié davantage : tout le cours de l’Èvre, au-delà de ce gonfanon féodal prestigieux me paraissait baigner dans une lumière plus fine, plus précieuse. La dernière fois que j’ai vu le bateau-lavoir de La Guérinière, il y a bien des années déjà, il avait sombré en donnant de la bande sur un banc de glaise, mais seulement jusqu’à mi-hauteur des colonnettes qui soutenaient le dais, un peu dans la posture sans panache de la flotte de Vichy sabordée à Toulon sur un petit fond : il me sembla que tout un fantasme de jeunesse avec lui avait donné du nez sans remous dans la vase.
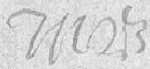 OudemiaBon génie
OudemiaBon génie
e-Wanderer a écrit:Barbey d'Aurevilly, l'incipit de L'Encorcelée :

J'y pensais en ouvrant ce fil que je ne connaissais pas.
Je connais les lieux, mais pas le texteCripure a écrit:Super. Je l'ai retrouvé numérisé. J'avais la flemme de le retaper.
Du coup, je mets tout, c'est assez long. Ne trichez pas avec gougueule : qui c'est ?
- Spoiler:
[…] Le vallon dormant de l’Èvre, petit affluent inconnu de la Loire qui débouche dans le fleuve à quinze cents mètres de Saint-Florent, enclôt dans le paysage de mes années lointaines un canton privilégié, plus secrètement, plus somptueusement coloré que les autres, une réserve fermée qui reste liée de naissance aux seules idées de promenade, de loisir et de fête agreste. Ce qui constituait d’abord pour moi, il me semble, sa singularité, c’était que l’Èvre, comme certains fleuves fabuleux de l’ancienne Afrique, n’avait ni source ni embouchure qu’on pût visiter. Du côté de la Loire, un barrage noyé, fait de moellons bruts culbutés en vrac, et qu’on pouvait traverser à sec en été vers L’Île aux Bergères, empêche de remonter la rivière à partir du fleuve ; un fouillis de frênes, de peupliers et de saules cernait le lacis des bras au-delà du barrage, et décourageait l’exploration vers l’aval. Vers l’amont, à cinq ou six kilomètres, un barrage de moulin, à Coulènes, interdit aux barques de remonter plus avant. Aller sur l’Èvre se trouvait ainsi lié à un cérémonial assez exigeant qu’il convenait de prévoir un jour ou deux à l’avance : le temps d’alerter dans un café du Marillais la tenancière et de retenir l’unique bachot centenaire – bancal, délabré, vermoulu, cloqué de gou-dron, et parfois dépourvu de gouvernail – qu’elle gardait cadenassé près du barrage et prêtait aux consommateurs de son établissement ; en guise de tolets, la tige des avirons dépareillés coulissait dans un nœud d’osier. La brûlure piquante et assoiffante de la limonade tiède reste par là inséparable dans mon souvenir des préparatifs de l’appareillage : je la retrouve intacte sur ma langue quand je relis le récit du pique-nique au bord du Cher dans Le Grand Meaulnes. Là comme au Marillais elle fait exploser encore contre mon palais je ne sais quel goût exotique et perdu de jeudi carillonné et de frairie modeste.
On s’embarquait – on s’embarque, je pense, toujours – au bas d’un escalier de planches qui dégringolait la haute berge glaiseuse ; les branches se croisaient au-dessus de l’étroit chenal d’eau noire ; on entrait de plain-pied dans une zone de silence plus subtil et comme alerté, ami de l’eau comme l’est la brume, et que rompait seulement l’égouttement plat et liquide des pales des avirons relevés. Presque aussitôt venait battre un instant le bordé l’écho à la fois caverneux et étoffé de la voûte du pont de pierre ; au-delà, la rivière s’élargissait entre des prairies basses bordées de rouches, roseaux coupants où s’embusquait parfois, palissadé jusqu’au menton, un pêcheur figé et soupçonneux comme une sentinelle ; là s’étalaient déjà partout en travers de la rivière les constellations vertes et flottantes des peuplements de châtaignes d’eau qu’on soulevait au retour et qu’on inspectait comme des filets pour y récolter les macres aux cornes aiguës : petits crânes végétaux épineux que la cuisson durcit et qui livrent, fendus, en guise de cervelle, une noisette au goût douceâtre de sucre et de vase, friable et grenue, et qui crisse entre les dents.
Rien n’est surprenant dans mon souvenir comme la variété miniaturiste des paysages que longe le cours sinueux de la rivière dans l’espace de ces quelques kilomètres : si lentement que glisse la barque dans l’eau stagnante, d’une couleur de café très dilué, ils semblent se succéder et se remplacer à la vitesse huilée des décors d’une scène à transformation, ou de ces toiles de diorama qui s’enroulaient et se déroulaient et défilaient devant le passager de Luna-Park assis dans sa barque vissée au plancher. Le plaisir exceptionnellement vif, et presque l’illusion de fausse reconnaissance, que m’a procuré dès les premières pages la lecture du Domaine d’Arnheim tient, je pense, à la sensation que la nouvelle de Poe communique simultanément de l’immobilité parfaite de l’eau et de la vitesse réglée de l’esquif qui semble moins saisi par un courant que plutôt tiré de l’avant par un aimant invisible. Plus tard, le cygne de Lohengrin, remontant, puis descendant sur la scène de l’Opéra les lacets de la rivière, m’a rendu une fois encore, fugitivement, cette sensation de félicité presque inquiétante qui tient – je ne l’ai compris qu’alors – à l’impression d’accélération faible et continue qui naît d’une telle navigation surnaturelle. Le sentiment de l’appel dans toute son urgence confiante loge pour nous dans ces esquifs ingénus – cygnes, caïques, auges de pierre – qui glissent dans les contes à la surface d’une eau immobile : à l’inverse de la suggestion toujours maléfique qui s’attache à l’apparition des objets volants non identifiés, le bonheur toujours, l’exaucement d’un vœu, tout au moins le secours surnaturel dans le péril, semble éperonner leur navigation silencieuse.
Je parle d’Edgar Poe, et voici qu’il ne va plus guère me quitter tout au long de cette excursion tant de fois recommencée – bien souvent en compagnie bruyante et joyeuse – et qui pourtant, non pas seulement dans mon souvenir, mais chaque fois et pendant même que je la recommençais, a gardé toujours quelque chose de l’allure du rêve, dans le défilé muet, incompréhensiblement majestueux, des deux rives qui viennent à moi et s’écartent comme les lèvres d’une Mer Rouge fendue, dans le sentiment à la fois de lenteur irréelle et de vitesse lisse que j’ai cru retrouver parfois dans les plus beaux, les plus vastes rêves d’opium de De Quincey. L’eau noire, l’eau lourde, l’eau mangeuse d’ombres qu’a décrite Gaston Bachelard, celle qui ceinture l’Île de la fée, celle qui attend au creux de ses douves de se refermer sur les décombres de la Maison Usher – si différente du flot insidieusement violent qui râpe et ratisse les grèves de la Loire, et renverse par les épaules comme un chien joueur le nageur qui cherche à reprendre pied – elle était là, elle fut pour moi tout de suite, avec son odeur terreuse de vase et de racines, son sommeil dissolvant : digérant, infusant lentement les feuilles mortes qui pleuvaient des arbres d’automne. Je n’y ai jamais plongé sans malaise : froide, inerte, sans éclaboussures et sans jaillissement, comme si on y avait plongé à travers une pellicule de lentilles d’eau.
Dès qu’on s’engageait sur l’Èvre, on pénétrait dans un canton retranché de la terre, dont la barque seule pouvait livrer la clef. Un sentier herbeux, le Chemin Vert, longe une des rives à partir du pont du Marillais sur quelques centaines de mètres et se termine en impasse à l’entrée d’un pré bossu ; au-delà, les clôtures de haies vives des prairies s’étendent jusqu’à la berge, que ne rejoint plus aucun chemin. Ainsi, quand nous passions en vue de la ferme de La Jolivière, haut perchée au-dessus de la rive sur son coteau, je m’étonnais toujours d’avoir pu la rejoindre deux ou trois fois par la voie de terre, à travers un lacis compliqué de chemins creux, itinéraire consacré de la longue file indienne que précédait chaque printemps la clochette des Rogations ; cette marche d’escalier du versant haut séparait deux parcours rituels d’espèce différente qui n’auraient jamais dû se recouper : voir le troupeau de la ferme dégringoler la coulée boueuse et venir boire tout uniment à la rivière me scandalisait, comme s’il avait violé une frontière mystique. Mais c’était bien là de tout le trajet le seul point où un témoin désenchantant de la terre cultivée fût un instant en vue ; la petite rivière semblait de bout en bout zigzaguer à travers un parc naturel ensauvagé, un recès protégé du loisir et du dimanche, où nulle part ne se montraient les stigmates du travail.
L’Èvre n’a guère qu’une vingtaine de mètres de large, parfois moins ; le lit est profond, criblé entre les souches pourries de trous et d’anfractuosités où s’abritent les brochets géants. Sans doute la pollution a-t-elle dépeuplé aujourd’hui la rivière comme toutes les autres, mais dans mon enfance, une partie de pêche sur l’Èvre signifiait qu’on courait sus au gros gibier : ces eaux couleur de réglisse passaient pour nourrir des bêtes centenaires, comme les étangs de Fontainebleau (et, pour mon imagination en tout cas, nul doute que l’Èvre profonde et noire était un peu comme cette mer ensorcelée du Manuscrit trouvé dans une bouteille, où tout ce qui y plongeait pouvait engraisser monstrueusement, même les navires). Quand on a passé le pont de pierre du Marillais, la rivière d’abord s’étale entre des prés mouillés où foisonnent au printemps les boutons d’or et les pâquerettes ; les bouquets de lances des roseaux de chaque côté pointent des berges, les avirons s’accrochent partout aux tiges noyées des nénuphars et des châtaignes d’eau qui ne découvrent qu’un étroit chenal d’eau libre. C’est encore ici le domaine des peupliers dont l’odeur des feuilles mortes sur les prés d’octobre, amère, astringente, qui rappelle parfois celle d’un vernis en train de sécher, est pour moi l’odeur même de l’automne dans la vallée. Ce sont presque, sur les deux rives, les gazons, les nymphées, les roselières décoratives et plumeuses d’un parc spacieux, mais les bruits de la vie courante ne se sont pas éteints d’un coup : le trot d’un cheval qui fait résonner au passage la voûte du pont de pierre se fait entendre encore de loin dans ma mémoire, le carillon languide qui tombe avec les heures du clocher du Marillais (on voit en se retournant sa silhouette quadrangulaire pointer par-dessus les roseaux et les touffes de carex) voyage longtemps jusqu’à vous sur les espaces d’eau morte. Le silence pourtant déjà se déchire malaisément ; il n’accueille plus que les échos espacés d’une vie distraite, que le rideau des peupliers commence à masquer. L’image du marais, qui s’est présentée un instant, juste après le pont, dans le caquètement des poules d’eau et le plongeon précipité des grenouilles cloquant l’eau pesante, laisse place pour un moment à celle des molles rivières de plaine qui vont entre les saules, dénouées comme une écharpe, infusées de soleil, traversées du vol des martins-pêcheurs et des libellules. Çà et là, une trouée ménagée entre les rouches aboutit sur la berge à deux ou trois gradins de planches pourries ; la gaule qui s’y incline en permanence comme une enseigne d’estaminet marque l’emplacement des affûts de pêche enviés qu’on se léguait ici autrefois de père en fils. Mais ces signes d’une présence humaine alertée sont trompeurs, comme les cabanes des alpages qui de loin font croire la montagne peuplée : quand on passe à l’aplomb de la trouée, la place est vide et la gaule fichée dans la glaise ; le propriétaire, qui se glisse sans bruit par intervalles de l’une à l’autre, en surveille parfois quatre ou cinq. Cette artillerie côtière parcimonieusement servie ne dépasse pas le bout du Chemin Vert, qui joue ici un peu avec ses écrans de roseaux le rôle d’un chemin de ronde, le long duquel les sentinelles se déplacent à couvert de créneau à créneau ; au-delà, la tension qu’on éprouve à longer un secteur miné et patrouillé cesse, et avec elle la consigne du silence. Déjà, plusieurs fois, la rivière s’est coudée ; le clocher du Marillais a disparu derrière les peupliers ; les coteaux bas qui bordent à distance les prés mouillés se resserrent et se rapprochent. Je suis allé bien souvent à pied au bout du Chemin Vert pique-niquer sur l’herbe. Ce qui commence plus loin, au-delà de la bosse d’une colline qui vient border la berge, c’est une autre contrée, non praticable au pied, non carrossable à la voiture, dont l’accès est réservé à certaines journées fastes : journées sans nuages de fête et de chaleur, que le soleil dès le matin consacre, et dont l’eau seule ouvre le chemin.
Presque tous les rituels d’initiation, si modeste qu’en soit l’objet, comportent le franchissement d’un couloir obscur, et il y a dans la promenade de l’Èvre un moment ingrat où l’attention se détourne, et où le regard se fait plus distrait. La rivière se resserre et se calibre ; les plantes d’eau et même les roseaux des rives un moment disparaissent. Les berges maintenant hautes et ébouleuses mettent à nu les racines des saules et des frênes têtards qui les retiennent mal ; les galeries des rats d’eau sapent de partout ces petites falaises instables. La berge s’élevant, on n’aperçoit plus, de la barque, que le plan d’eau étroit, les couleurs de la glaise qui le borde, les racines déchaussées, les rats qui cavalcadent sur les banquettes d’argile mouillée, et parfois la double ride fine, l’angle obtus du sillage d’une couleuvre qui traverse la rivière : pour un instant, un sentiment proche du malaise flotte sur ces berges cariées où s’anime un peu trop le trotte-menu de la boue. Mais, très vite, de nouveau la perspective change et s’aère : un objet flottant à la silhouette indéfinissable, qui tient à la fois du dais de la Fête-Dieu et d’une pagode de Lilliput, est en vue, amarré à demeure à la rive ; en approchant, le bordé très bas qui rase l’eau, le tendelet de zinc ajouré qui abrite la nacelle quadrangulaire, les traînées savonneuses qui s’allongent parfois à la surface de L’Èvre, font pressentir sa destination modestement utilitaire, mais cet ustensile miniaturiste est à un vrai bateau-lavoir à peu près ce qu’est une chaloupe à un vaisseau à trois ponts : il est triplace, et réservé aux seules lessives privées du château tout proche, dont on commence à apercevoir les girouettes au-delà d’une clairière de gazon anglais. Rien ne me jetait, enfant, dans un éblouissement aussi total, aussi éperdu, que le détournement à des fins privées d’un meuble dans mon esprit aussi électivement municipal : la possession par le châtelain d’un commissariat de police ou d’une caserne de sapeurs-pompiers ne m’eût pas stupéfié davantage : tout le cours de l’Èvre, au-delà de ce gonfanon féodal prestigieux me paraissait baigner dans une lumière plus fine, plus précieuse. La dernière fois que j’ai vu le bateau-lavoir de La Guérinière, il y a bien des années déjà, il avait sombré en donnant de la bande sur un banc de glaise, mais seulement jusqu’à mi-hauteur des colonnettes qui soutenaient le dais, un peu dans la posture sans panache de la flotte de Vichy sabordée à Toulon sur un petit fond : il me sembla que tout un fantasme de jeunesse avec lui avait donné du nez sans remous dans la vase.
- Pour laisser les autres jouer:
- Julien Gracq
 MictlantecuhtliNiveau 9
MictlantecuhtliNiveau 9
DesolationRow a écrit:Alexandrie, dans le Quatuor de Lawrence Durrell.



Je me tue à faire découvrir ce chef-d'œuvre à mes amis. Beaucoup n'en ont jamais (!) entendu parler (alors que bon, il a fait mes malheurs en prépa, mais c'est une autre histoire...).
_________________
Ō miserās hominum mentēs, ō pectora cæca !
Quālibus in tenebrīs uītæ quantīsque perīclīs
dēgitur hoc æuī quodcumquest ! Nōnne uidēre
nīl aliud sibi nātūram lātrāre, nisi ut quī
corpore sēiūnctus dolor absit — mente fruātur
iūcundō sēnsū, cūrā sēmōta metūque ?
 artaxerxesNiveau 6
artaxerxesNiveau 6
C’étaient de ces chambres de province qui,—de même qu’en certains pays des parties entières de l’air ou de la mer sont illuminées ou parfumées par des myriades de protozoaires que nous ne voyons pas,—nous enchantent des mille odeurs qu’y dégagent les vertus, la sagesse, les habitudes, toute une vie secrète, invisible, surabondante et morale que l’atmosphère y tient en suspens ; odeurs naturelles encore, certes, et couleur du temps comme celles de la campagne voisine, mais déjà casanières, humaines et renfermées, gelée exquise industrieuse et limpide de tous les fruits de l’année qui ont quitté le verger pour l’armoire ; saisonnières, mais mobilières et domestiques, corrigeant le piquant de la gelée blanche par la douceur du pain chaud, oisives et ponctuelles comme une horloge de village, flâneuses et rangées, insoucieuses et prévoyantes, lingères, matinales, dévotes, heureuses d’une paix qui n’apporte qu’un surcroît d’anxiété et d’un prosaïsme qui sert de grand réservoir de poésie à celui qui la traverse sans y avoir vécu. L’air y était saturé de la fine fleur d’un silence si nourricier, si succulent que je ne m’y avançais qu’avec une sorte de gourmandise, surtout par ces premiers matins encore froids de la semaine de Pâques où je le goûtais mieux parce que je venais seulement d’arriver à Combray : avant que j’entrasse souhaiter le bonjour à ma tante on me faisait attendre un instant, dans la première pièce où le soleil, d’hiver encore, était venu se mettre au chaud devant le feu, déjà allumé entre les deux briques et qui badigeonnait toute la chambre d’une odeur de suie, en faisait comme un de ces grands « devants de four » de campagne, ou de ces manteaux de cheminée de châteaux, sous lesquels on souhaite que se déclarent dehors la pluie, la neige, même quelque catastrophe diluvienne pour ajouter au confort de la réclusion la poésie de l’hivernage ; je faisais quelques pas du prie-Dieu aux fauteuils en velours frappé, toujours revêtus d’un appui-tête au crochet ; et le feu cuisant comme une pâte les appétissantes odeurs dont l’air de la chambre était tout grumeleux et qu’avait déjà fait travailler et « lever » la fraîcheur humide et ensoleillée du matin, il les feuilletait, les dorait, les godait, les boursouflait, en faisant un invisible et palpable gâteau provincial, un immense « chausson » où, à peine goûtés les arômes plus croustillants, plus fins, plus réputés, mais plus secs aussi du placard, de la commode, du papier à ramages, je revenais toujours avec une convoitise inavouée m’engluer dans l’odeur médiane, poisseuse, fade, indigeste et fruitée du couvre-lit à fleurs.
_________________
L'homme crie où son fer le ronge
Et sa plaie engendre un soleil
Plus beau que les anciens mensonges.
 AncolieExpert spécialisé
AncolieExpert spécialisé
Rien de littéraire. Gamine c'était ma vue quotidienne et j'étais fière du fond de ma cambrousse qu'un écrivain ait écrit que c'était l'une des plus belles vues du monde. (Je laisse deviner comme Cripure mais c'était facile pour son auteur  )
)
Mais avant d’arriver à Tullins j’ai trouvé une surprise délicieuse ; par bonheur, personne ne m’avait averti. Je suis arrivé tout à coup à une des plus belles vues du monde. C’est après avoir passé le petit village de Cras, en commençant à descendre vers Tullins. Tout à coup se découvre à vos yeux un immense paysage, comparable aux plus riches du Titien Sur le premier plan, le château de Vourey. À droite, l’Isère, serpentant à l’infini, jusqu’à l’extrémité de l’horizon, et jusqu’à Grenoble. Cette rivière, fort large, arrose la plaine la plus fertile, la mieux cultivée, la mieux plantée, et de la plus riche verdure. Au-dessus de cette plaine, la plus magnifique peut-être dont la France puisse se vanter, c’est la chaîne des Alpes, et des pics de granit se dessinant en rouge noir sur des neiges éternelles, qui n’ont pu tenir sur leurs parois trop rapides. On a devant soi le Grand Som et les belles montagnes de la Chartreuse ; à gauche, des coteaux boisés aux formes hardies. Le genre ennuyeux semble banni de ces belles contrées.
Je ne conçois pas la force de végétation de ces champs couverts d’arbres rapprochés, vigoureux, touffus ; et là-dessous il y a du blé, du chanvre, les plus belles récoltes. Je n’ai rien vu de plus étonnant en courant la sublime Lombardie, ou à Naples, dans la terre de Labour. La montagne que l’on descend à Cras fait partie de la chaîne du Jura, qui court de Bâle à Fontaneille, près Sault, dans le bas Dauphiné. J’ai dit au postillon que j’avais un éblouissement, et que je voulais marcher ; il est allé m’attendre, sans répliquer un mot, au bas de la descente. Ainsi rien n’a gâté mon bonheur.
Mais avant d’arriver à Tullins j’ai trouvé une surprise délicieuse ; par bonheur, personne ne m’avait averti. Je suis arrivé tout à coup à une des plus belles vues du monde. C’est après avoir passé le petit village de Cras, en commençant à descendre vers Tullins. Tout à coup se découvre à vos yeux un immense paysage, comparable aux plus riches du Titien Sur le premier plan, le château de Vourey. À droite, l’Isère, serpentant à l’infini, jusqu’à l’extrémité de l’horizon, et jusqu’à Grenoble. Cette rivière, fort large, arrose la plaine la plus fertile, la mieux cultivée, la mieux plantée, et de la plus riche verdure. Au-dessus de cette plaine, la plus magnifique peut-être dont la France puisse se vanter, c’est la chaîne des Alpes, et des pics de granit se dessinant en rouge noir sur des neiges éternelles, qui n’ont pu tenir sur leurs parois trop rapides. On a devant soi le Grand Som et les belles montagnes de la Chartreuse ; à gauche, des coteaux boisés aux formes hardies. Le genre ennuyeux semble banni de ces belles contrées.
Je ne conçois pas la force de végétation de ces champs couverts d’arbres rapprochés, vigoureux, touffus ; et là-dessous il y a du blé, du chanvre, les plus belles récoltes. Je n’ai rien vu de plus étonnant en courant la sublime Lombardie, ou à Naples, dans la terre de Labour. La montagne que l’on descend à Cras fait partie de la chaîne du Jura, qui court de Bâle à Fontaneille, près Sault, dans le bas Dauphiné. J’ai dit au postillon que j’avais un éblouissement, et que je voulais marcher ; il est allé m’attendre, sans répliquer un mot, au bas de la descente. Ainsi rien n’a gâté mon bonheur.
 User5899Demi-dieu
User5899Demi-dieu
Décidément, la littérature est bien une affaire de longueurs de phrases 
- Spoiler:
- Vous avez sept heures

 AncolieExpert spécialisé
AncolieExpert spécialisé
Cripure a écrit:Décidément, la littérature est bien une affaire de longueurs de phrases
- Spoiler:
C'est un peu juste :lol:
 RogerMartinBon génie
RogerMartinBon génie
Oudemia a écrit:e-Wanderer a écrit:Barbey d'Aurevilly, l'incipit de L'Encorcelée :
J'y pensais en ouvrant ce fil que je ne connaissais pas.Je connais les lieux, mais pas le texteCripure a écrit:Super. Je l'ai retrouvé numérisé. J'avais la flemme de le retaper.
Du coup, je mets tout, c'est assez long. Ne trichez pas avec gougueule : qui c'est ?
- Spoiler:
[…] Le vallon dormant de l’Èvre, petit affluent inconnu de la Loire qui débouche dans le fleuve à quinze cents mètres de Saint-Florent, enclôt dans le paysage de mes années lointaines un canton privilégié, plus secrètement, plus somptueusement coloré que les autres, une réserve fermée qui reste liée de naissance aux seules idées de promenade, de loisir et de fête agreste. Ce qui constituait d’abord pour moi, il me semble, sa singularité, c’était que l’Èvre, comme certains fleuves fabuleux de l’ancienne Afrique, n’avait ni source ni embouchure qu’on pût visiter. Du côté de la Loire, un barrage noyé, fait de moellons bruts culbutés en vrac, et qu’on pouvait traverser à sec en été vers L’Île aux Bergères, empêche de remonter la rivière à partir du fleuve ; un fouillis de frênes, de peupliers et de saules cernait le lacis des bras au-delà du barrage, et décourageait l’exploration vers l’aval. Vers l’amont, à cinq ou six kilomètres, un barrage de moulin, à Coulènes, interdit aux barques de remonter plus avant. Aller sur l’Èvre se trouvait ainsi lié à un cérémonial assez exigeant qu’il convenait de prévoir un jour ou deux à l’avance : le temps d’alerter dans un café du Marillais la tenancière et de retenir l’unique bachot centenaire – bancal, délabré, vermoulu, cloqué de gou-dron, et parfois dépourvu de gouvernail – qu’elle gardait cadenassé près du barrage et prêtait aux consommateurs de son établissement ; en guise de tolets, la tige des avirons dépareillés coulissait dans un nœud d’osier. La brûlure piquante et assoiffante de la limonade tiède reste par là inséparable dans mon souvenir des préparatifs de l’appareillage : je la retrouve intacte sur ma langue quand je relis le récit du pique-nique au bord du Cher dans Le Grand Meaulnes. Là comme au Marillais elle fait exploser encore contre mon palais je ne sais quel goût exotique et perdu de jeudi carillonné et de frairie modeste.
On s’embarquait – on s’embarque, je pense, toujours – au bas d’un escalier de planches qui dégringolait la haute berge glaiseuse ; les branches se croisaient au-dessus de l’étroit chenal d’eau noire ; on entrait de plain-pied dans une zone de silence plus subtil et comme alerté, ami de l’eau comme l’est la brume, et que rompait seulement l’égouttement plat et liquide des pales des avirons relevés. Presque aussitôt venait battre un instant le bordé l’écho à la fois caverneux et étoffé de la voûte du pont de pierre ; au-delà, la rivière s’élargissait entre des prairies basses bordées de rouches, roseaux coupants où s’embusquait parfois, palissadé jusqu’au menton, un pêcheur figé et soupçonneux comme une sentinelle ; là s’étalaient déjà partout en travers de la rivière les constellations vertes et flottantes des peuplements de châtaignes d’eau qu’on soulevait au retour et qu’on inspectait comme des filets pour y récolter les macres aux cornes aiguës : petits crânes végétaux épineux que la cuisson durcit et qui livrent, fendus, en guise de cervelle, une noisette au goût douceâtre de sucre et de vase, friable et grenue, et qui crisse entre les dents.
Rien n’est surprenant dans mon souvenir comme la variété miniaturiste des paysages que longe le cours sinueux de la rivière dans l’espace de ces quelques kilomètres : si lentement que glisse la barque dans l’eau stagnante, d’une couleur de café très dilué, ils semblent se succéder et se remplacer à la vitesse huilée des décors d’une scène à transformation, ou de ces toiles de diorama qui s’enroulaient et se déroulaient et défilaient devant le passager de Luna-Park assis dans sa barque vissée au plancher. Le plaisir exceptionnellement vif, et presque l’illusion de fausse reconnaissance, que m’a procuré dès les premières pages la lecture du Domaine d’Arnheim tient, je pense, à la sensation que la nouvelle de Poe communique simultanément de l’immobilité parfaite de l’eau et de la vitesse réglée de l’esquif qui semble moins saisi par un courant que plutôt tiré de l’avant par un aimant invisible. Plus tard, le cygne de Lohengrin, remontant, puis descendant sur la scène de l’Opéra les lacets de la rivière, m’a rendu une fois encore, fugitivement, cette sensation de félicité presque inquiétante qui tient – je ne l’ai compris qu’alors – à l’impression d’accélération faible et continue qui naît d’une telle navigation surnaturelle. Le sentiment de l’appel dans toute son urgence confiante loge pour nous dans ces esquifs ingénus – cygnes, caïques, auges de pierre – qui glissent dans les contes à la surface d’une eau immobile : à l’inverse de la suggestion toujours maléfique qui s’attache à l’apparition des objets volants non identifiés, le bonheur toujours, l’exaucement d’un vœu, tout au moins le secours surnaturel dans le péril, semble éperonner leur navigation silencieuse.
Je parle d’Edgar Poe, et voici qu’il ne va plus guère me quitter tout au long de cette excursion tant de fois recommencée – bien souvent en compagnie bruyante et joyeuse – et qui pourtant, non pas seulement dans mon souvenir, mais chaque fois et pendant même que je la recommençais, a gardé toujours quelque chose de l’allure du rêve, dans le défilé muet, incompréhensiblement majestueux, des deux rives qui viennent à moi et s’écartent comme les lèvres d’une Mer Rouge fendue, dans le sentiment à la fois de lenteur irréelle et de vitesse lisse que j’ai cru retrouver parfois dans les plus beaux, les plus vastes rêves d’opium de De Quincey. L’eau noire, l’eau lourde, l’eau mangeuse d’ombres qu’a décrite Gaston Bachelard, celle qui ceinture l’Île de la fée, celle qui attend au creux de ses douves de se refermer sur les décombres de la Maison Usher – si différente du flot insidieusement violent qui râpe et ratisse les grèves de la Loire, et renverse par les épaules comme un chien joueur le nageur qui cherche à reprendre pied – elle était là, elle fut pour moi tout de suite, avec son odeur terreuse de vase et de racines, son sommeil dissolvant : digérant, infusant lentement les feuilles mortes qui pleuvaient des arbres d’automne. Je n’y ai jamais plongé sans malaise : froide, inerte, sans éclaboussures et sans jaillissement, comme si on y avait plongé à travers une pellicule de lentilles d’eau.
Dès qu’on s’engageait sur l’Èvre, on pénétrait dans un canton retranché de la terre, dont la barque seule pouvait livrer la clef. Un sentier herbeux, le Chemin Vert, longe une des rives à partir du pont du Marillais sur quelques centaines de mètres et se termine en impasse à l’entrée d’un pré bossu ; au-delà, les clôtures de haies vives des prairies s’étendent jusqu’à la berge, que ne rejoint plus aucun chemin. Ainsi, quand nous passions en vue de la ferme de La Jolivière, haut perchée au-dessus de la rive sur son coteau, je m’étonnais toujours d’avoir pu la rejoindre deux ou trois fois par la voie de terre, à travers un lacis compliqué de chemins creux, itinéraire consacré de la longue file indienne que précédait chaque printemps la clochette des Rogations ; cette marche d’escalier du versant haut séparait deux parcours rituels d’espèce différente qui n’auraient jamais dû se recouper : voir le troupeau de la ferme dégringoler la coulée boueuse et venir boire tout uniment à la rivière me scandalisait, comme s’il avait violé une frontière mystique. Mais c’était bien là de tout le trajet le seul point où un témoin désenchantant de la terre cultivée fût un instant en vue ; la petite rivière semblait de bout en bout zigzaguer à travers un parc naturel ensauvagé, un recès protégé du loisir et du dimanche, où nulle part ne se montraient les stigmates du travail.
L’Èvre n’a guère qu’une vingtaine de mètres de large, parfois moins ; le lit est profond, criblé entre les souches pourries de trous et d’anfractuosités où s’abritent les brochets géants. Sans doute la pollution a-t-elle dépeuplé aujourd’hui la rivière comme toutes les autres, mais dans mon enfance, une partie de pêche sur l’Èvre signifiait qu’on courait sus au gros gibier : ces eaux couleur de réglisse passaient pour nourrir des bêtes centenaires, comme les étangs de Fontainebleau (et, pour mon imagination en tout cas, nul doute que l’Èvre profonde et noire était un peu comme cette mer ensorcelée du Manuscrit trouvé dans une bouteille, où tout ce qui y plongeait pouvait engraisser monstrueusement, même les navires). Quand on a passé le pont de pierre du Marillais, la rivière d’abord s’étale entre des prés mouillés où foisonnent au printemps les boutons d’or et les pâquerettes ; les bouquets de lances des roseaux de chaque côté pointent des berges, les avirons s’accrochent partout aux tiges noyées des nénuphars et des châtaignes d’eau qui ne découvrent qu’un étroit chenal d’eau libre. C’est encore ici le domaine des peupliers dont l’odeur des feuilles mortes sur les prés d’octobre, amère, astringente, qui rappelle parfois celle d’un vernis en train de sécher, est pour moi l’odeur même de l’automne dans la vallée. Ce sont presque, sur les deux rives, les gazons, les nymphées, les roselières décoratives et plumeuses d’un parc spacieux, mais les bruits de la vie courante ne se sont pas éteints d’un coup : le trot d’un cheval qui fait résonner au passage la voûte du pont de pierre se fait entendre encore de loin dans ma mémoire, le carillon languide qui tombe avec les heures du clocher du Marillais (on voit en se retournant sa silhouette quadrangulaire pointer par-dessus les roseaux et les touffes de carex) voyage longtemps jusqu’à vous sur les espaces d’eau morte. Le silence pourtant déjà se déchire malaisément ; il n’accueille plus que les échos espacés d’une vie distraite, que le rideau des peupliers commence à masquer. L’image du marais, qui s’est présentée un instant, juste après le pont, dans le caquètement des poules d’eau et le plongeon précipité des grenouilles cloquant l’eau pesante, laisse place pour un moment à celle des molles rivières de plaine qui vont entre les saules, dénouées comme une écharpe, infusées de soleil, traversées du vol des martins-pêcheurs et des libellules. Çà et là, une trouée ménagée entre les rouches aboutit sur la berge à deux ou trois gradins de planches pourries ; la gaule qui s’y incline en permanence comme une enseigne d’estaminet marque l’emplacement des affûts de pêche enviés qu’on se léguait ici autrefois de père en fils. Mais ces signes d’une présence humaine alertée sont trompeurs, comme les cabanes des alpages qui de loin font croire la montagne peuplée : quand on passe à l’aplomb de la trouée, la place est vide et la gaule fichée dans la glaise ; le propriétaire, qui se glisse sans bruit par intervalles de l’une à l’autre, en surveille parfois quatre ou cinq. Cette artillerie côtière parcimonieusement servie ne dépasse pas le bout du Chemin Vert, qui joue ici un peu avec ses écrans de roseaux le rôle d’un chemin de ronde, le long duquel les sentinelles se déplacent à couvert de créneau à créneau ; au-delà, la tension qu’on éprouve à longer un secteur miné et patrouillé cesse, et avec elle la consigne du silence. Déjà, plusieurs fois, la rivière s’est coudée ; le clocher du Marillais a disparu derrière les peupliers ; les coteaux bas qui bordent à distance les prés mouillés se resserrent et se rapprochent. Je suis allé bien souvent à pied au bout du Chemin Vert pique-niquer sur l’herbe. Ce qui commence plus loin, au-delà de la bosse d’une colline qui vient border la berge, c’est une autre contrée, non praticable au pied, non carrossable à la voiture, dont l’accès est réservé à certaines journées fastes : journées sans nuages de fête et de chaleur, que le soleil dès le matin consacre, et dont l’eau seule ouvre le chemin.
Presque tous les rituels d’initiation, si modeste qu’en soit l’objet, comportent le franchissement d’un couloir obscur, et il y a dans la promenade de l’Èvre un moment ingrat où l’attention se détourne, et où le regard se fait plus distrait. La rivière se resserre et se calibre ; les plantes d’eau et même les roseaux des rives un moment disparaissent. Les berges maintenant hautes et ébouleuses mettent à nu les racines des saules et des frênes têtards qui les retiennent mal ; les galeries des rats d’eau sapent de partout ces petites falaises instables. La berge s’élevant, on n’aperçoit plus, de la barque, que le plan d’eau étroit, les couleurs de la glaise qui le borde, les racines déchaussées, les rats qui cavalcadent sur les banquettes d’argile mouillée, et parfois la double ride fine, l’angle obtus du sillage d’une couleuvre qui traverse la rivière : pour un instant, un sentiment proche du malaise flotte sur ces berges cariées où s’anime un peu trop le trotte-menu de la boue. Mais, très vite, de nouveau la perspective change et s’aère : un objet flottant à la silhouette indéfinissable, qui tient à la fois du dais de la Fête-Dieu et d’une pagode de Lilliput, est en vue, amarré à demeure à la rive ; en approchant, le bordé très bas qui rase l’eau, le tendelet de zinc ajouré qui abrite la nacelle quadrangulaire, les traînées savonneuses qui s’allongent parfois à la surface de L’Èvre, font pressentir sa destination modestement utilitaire, mais cet ustensile miniaturiste est à un vrai bateau-lavoir à peu près ce qu’est une chaloupe à un vaisseau à trois ponts : il est triplace, et réservé aux seules lessives privées du château tout proche, dont on commence à apercevoir les girouettes au-delà d’une clairière de gazon anglais. Rien ne me jetait, enfant, dans un éblouissement aussi total, aussi éperdu, que le détournement à des fins privées d’un meuble dans mon esprit aussi électivement municipal : la possession par le châtelain d’un commissariat de police ou d’une caserne de sapeurs-pompiers ne m’eût pas stupéfié davantage : tout le cours de l’Èvre, au-delà de ce gonfanon féodal prestigieux me paraissait baigner dans une lumière plus fine, plus précieuse. La dernière fois que j’ai vu le bateau-lavoir de La Guérinière, il y a bien des années déjà, il avait sombré en donnant de la bande sur un banc de glaise, mais seulement jusqu’à mi-hauteur des colonnettes qui soutenaient le dais, un peu dans la posture sans panache de la flotte de Vichy sabordée à Toulon sur un petit fond : il me sembla que tout un fantasme de jeunesse avec lui avait donné du nez sans remous dans la vase., alors je crois avoir trouvé
- Pour laisser les autres jouer:
Je pense comme Oudemia!!! à cause des références à Poe. Mais est ce que j'ai déjà lu le texte??? Quelle horreur, j'ai pratiquement tout oublié du détail de mes lectures de prépa.
 User5899Demi-dieu
User5899Demi-dieu
C'est un texte très court de 76. On a dû être en prépa en gros les mêmes années, donc un poil plus tard, on ne le lisait pas en prépa. Je l'ai découvert tout seul, en tout cas.
Page 1 sur 2 • 1, 2 

- HELP! besoin infos l'envers du décors du bac
- Littérature et société : Libération consacre un dossier au fait divers et à la littérature
- Y. Citton, Philosophie et littérature en débats (I): Faire son deuil de la littérature pour mieux promouvoir le littéraire
- [Lettres] Humanités, littérature et philosophie : côté littérature
- Séquence Paysages en poésie
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum



